Le terme « impact » me semble un peu fort pour évoquer la part consciente des re stes du vécu de notre enfance, des souvenirs. Un impact suppose un projectile heurtant violemment une surface, ou un autre projectile. Ce peut être nous qui nous cognons sur un objet extérieur, modifiant le cours de notre progression, voire la stoppant, tel ce passant éprouvant soudainement la dureté de la colonne en acier d’un panneau indicateur qu’il n’a pas vu ; ou bien, qu’un élément étranger, pas nécessairement funeste, nous percute, comme par exemple l’inénarrable regard de notre nouvelle voisine de pallier, et avec pour même effet d’altérer le cours de notre réalité. Un impact est donc un choc, c'est-à-dire un événement réel ne concernant que le présent de l’action. Il peut alors en résulter une empreinte, une trace soumise à l’érosion du temps, autrement dit au langage, à l’interprétation, ce que nous appelons un « souvenir ». Il y a donc là deux temps qui par nature ne peuvent coexister : celui de « l’impact », le présent, réel, et celui du « souvenir », l’après-coup, l’interprétation d’un présent révolu, notre réalité.
stes du vécu de notre enfance, des souvenirs. Un impact suppose un projectile heurtant violemment une surface, ou un autre projectile. Ce peut être nous qui nous cognons sur un objet extérieur, modifiant le cours de notre progression, voire la stoppant, tel ce passant éprouvant soudainement la dureté de la colonne en acier d’un panneau indicateur qu’il n’a pas vu ; ou bien, qu’un élément étranger, pas nécessairement funeste, nous percute, comme par exemple l’inénarrable regard de notre nouvelle voisine de pallier, et avec pour même effet d’altérer le cours de notre réalité. Un impact est donc un choc, c'est-à-dire un événement réel ne concernant que le présent de l’action. Il peut alors en résulter une empreinte, une trace soumise à l’érosion du temps, autrement dit au langage, à l’interprétation, ce que nous appelons un « souvenir ». Il y a donc là deux temps qui par nature ne peuvent coexister : celui de « l’impact », le présent, réel, et celui du « souvenir », l’après-coup, l’interprétation d’un présent révolu, notre réalité.
Il nous faut donc, ici, bien distinguer « réel » (l'impact) et « réalité » (l'interprétation), ce que la philosophie a d’ailleurs fait sans attendre la psychanalyse. Disons que le réel est ce qui échappe au langage, c’est là où rien ne manque (la mort, l'altérité, les yeux de ma voisine de pallier, etc...). La réalité (l'après-coup donc), quant à elle, est ce que nous restituons du réel au travers de nos filtres émotionnels et que l’on transforme en symboles, en images, en mots, en métaphores, c'est un point de vue au regard de nos précédentes expériences dans la perception singulière que chacun avons du temps et de l'espace, alors même que le réel est intemporel et sans limite, il est, c’est tout. Contrairement au réel, la réalité est mouvante, fluctuante, sujette à débat, celle d’aujourd’hui n’étant pas nécessairement celle d’hier, ni celle de demain. Ainsi, la formulation de notre thème, « l’impact des souvenirs… », laisserait supposer que lesdits souvenirs (notre réalité) puissent entrer dans le champs du réel, c'est-à-dire une perception brute, instantanée, une sensation engrangée telle quelle dans notre inconscient et refaisant soudainement surface en l’état, comme le goût de la fameuse madeleine proustienne, mais qu’il soit alors plus approprié de parler de réminiscence, une sensation hors de propos et venue d'on ne sait où, sur laquelle on ne peut encore accrocher de symboles, de mots. L'intitulé de notre débat serait par conséquent « l'impact des réminiscences d'enfance » et, par là même, la nécessité d'en amortir le choc par du langage, autrement dit, d'accéder au souvenir, de le construire.
Ainsi se fonde la psychanalyse, avec pour premier temps de décoincer le réel en nous sous l'informe de réminiscence, puis, justement, de lui donner forme en tant que souvenirs, c'est-à-dire d'interprétations. Où l'on constate au passage que la psychanalyse ne s'intéresse qu'au présent du sujet, qu'il s'agisse de réel ou de réalité, le passé, comme son nom l'indique, étant à jamais du passé. Pour nous, la conservation du réel ne peut être que du domaine de l'inconscient, intemporel, siège des pulsions et des affects, que Freud nomma le « ça », à distinguer de la zone inconsciente du moi qui tend à lier l'énergie pulsionnelle en provenance du ça. Pour le dire autrement, nous emmagasinons le réel (l'impact) dans notre inconscient (le ça) sous forme de représentations, lesdites représentations générant des mouvements pulsionnels et susceptibles de faire retour jusqu'à notre conscience au travers d’autres représentations élaborées dans le préconscient (inconscient du moi). Freud distinguera ainsi deux sortes de représentations : de choses et de mots, les premières stockées dans l’inconscient et alimentant nos pulsions sous l’égide du principe de plaisir ; quant aux représentations de mots, préconscientes, elles sont en quelque sorte l'auto-censure visant à accorder la pulsion à notre réalité, à formaliser l’empreinte de l’impact sous la forme d’une trace énonçable, un souvenir (voir l'introduction au débat : Sortir de la trace, s'affranchir de l'empreinte - lien -).
Si tous les chocs ne sont pas mauvais, et qu’il en soit même de salutaires, envisager le souvenir en terme d’impact me semble renvoyer pour grande partie à la notion de traumatisme, lorsque ledit souvenir est identifié comme représentant le choc en soi, la chose en soi, alors que c’est le souvenir lui-même qui est traumatisant, c'est-à-dire l’interprétation présente d’un impact vécu antérieurement, quoi que toujours vif. A l’appui de cela, il n’est pas rare que deux personnes ayant subi la même et douloureuse collision avec le réel, un même impact potentiellement traumatisant, l’une en ressorte avec des blessures qui cicatrisent, et que l’autre ne puisse guérir, traumatisée. Ce n’est donc pas le choc en soi qui est traumatisant, mais son interprétation lorsque nous replaçons celui-ci dans le contexte émotionnel de nos précédentes représentations, de choses et de mots, dans la complexité de notre histoire, c'est-à-dire au regard actuel de notre expérience. La nature traumatique de l'impact n’est donc pas à rechercher dans le souvenir d’un fait isolé, mais dans nos représentations adjacentes, là où ça coince, où de précédentes expériences nous empêchent d’encaisser le choc. En somme, c’est l’accumulation d’impacts successifs auxquels viennent s’ajouter des représentations de mots inadéquats au regard de notre désir qui crée le traumatisme.
Cela étant, il en va de même des souvenirs heureux. Ainsi, lorsque je suis submergé par le troublant et néanmoins merveilleux émoi généré par le souvenir des yeux, entre autre, de ma nouvelle voisine de pallier, force me sera de constater cette invraisemblable fait que je suis le seul de mon pallier à être pareillement subjugué, et peut-être même le seul de l’immeuble... insensé ! Il y a donc là, dans ces yeux si troublants, quelque chose me renvoyant à la promesse d’un bonheur sans nom, oublié, que je suis pourtant seul à connaître, et avec lequel il me faut absolument renouer, mais quoi ? En somme, l’image de ma voisine a percuté mes représentations du bonheur, des représentations si profondément ancrées que ma voisine a pris la forme d’une évidence. Mais au fond, que m’importe lesdites représentations, le souvenir de ses yeux me suffit, d’autant que je ne vois pas trop l’intérêt de plonger en ces temps immémoriaux, préverbaux, où s’est gravé en moi, au sein de maman, le premier regard me signifiant déjà un retour à l’ultime félicité, puis, les autres représentations s’empilant sur celle-ci (d'où j'ai tiré quelques souvenirs d'enfance), jusqu’à aujourd’hui, où le souvenir d’un regard suffit à mon émoi, un émoi qui a déjà eu lieu, mais qui échappe à mon souvenir. Ainsi, le souvenir est l'expression de la chaine associative entre différentes représentations d'impacts (le signifié, l'entre les lignes). Reste de savoir si le signifié en question, l'entre les lignes du souvenir, exacerbe ma pulsion de vie, comme celui des yeux de ma voisine, auquel cas je n'ai pas besoin d'y toucher (au signifié, parce que ma voisine...), ou bien, si ledit signifié me plonge dans la morbidité, comme le souvenir d'un fait traumatisant, et que là, par contre, il soit judicieux d'aller tripatouiller mon signifié.
Cela étant, malgré ce que l'on pourrait supposer d'une certaine dilution du réel (l'impact) dans le symbolique (le langage), entre ces deux registres se trouve l'imaginaire, là où s'organise nos réminiscences, tant sous la poussée émanant du ça (l'inconscient), que sous les coupes franches d'un moi préconscient, censeur. L'imaginaire (notre rapport à l'image de soi et des autres) est donc en quelque sorte l'endroit où se construit la trame du scénario (le signifié) que le moi conscient élaborera sous forme de souvenirs. Mais il est des images difficilement censurables, qui débordent, et nous renvoient à cet afflux d'excitation que l'appareil psychique ne pût endiguer, le moi, débordé, n'étant plus à même de se protéger selon un scénario cohérent, construisant là des souvenirs écrans, ou, ici, des souvenirs dont le sens nous échappe, des mots qui ne peuvent dissiper le malaise, sortes de représentants de l'indicible, et donc à coté.
Approcher l'impact originaire sous forme de réminiscences, ou de souvenirs, est bien souvent impossible, recouvert d'une succession d'empreintes d'impacts ultérieurs et s'emboitant plus ou moins dans des traces précédentes, d'autres représentations . En fait, il nous faudrait creuser jusqu'au choc qui scinda l'être et le sujet, jusqu'à l'endroit où l'espace et la temporalité, l'Autre, firent leur entrée fracassante dans le réel du désormais sujet, à l'origine du désir, début du formatage de nos futures représentations. Ajoutons à cela que notre désir se modelant par des mécanismes identificatoires sur le désir de l'Autre, par nature inaccessible (voir l'introduction au débat : Le désir - lien -), et nous comprendrons que c'est la structure même de l'être qu'il nous faudrait décortiquer pour analyser la forme de l'impact qui nous préoccupe, cela pour en modifier la trace afin de pouvoir y fondre nos nécessités, elles mêmes déterminées par notre histoire... bref, on n'en sort pas... sauf par ce genre d'écriture qu'est le souvenir. En somme, si l'imaginaire (le signifié) influe sur la forme du souvenir, la trace consciente de l'impact, ça fonctionne aussi dans l'autre sens, que le souvenir (symbolique) influence à son tour l'imaginaire. C'est l'histoire de l'image de soi, où la perception que nous avons de notre image dans le miroir influence tout autant notre psychisme que celui-ci influence la perception en question. Lorsque nous passons devant un miroir, il y a toujours ce décalage, plus ou moins ténu, entre l'image que nous voyons et celle que nous nous faisons de nous-même ; c'est dans cet écart que s'écrit le souvenir, sans qu'il soit besoin de remonter en ces temps où le regard de maman nous signifia notre valeur.
Nous pourrions alors dire qu'un souvenir est notre rapport émotionnel à un contexte passé restitué symboliquement (par du langage) au travers de notre image, elle aussi passée, mais telle que nous la percevons aujourd'hui dans notre imaginaire. Une réminiscence, quant à elle, c'est encore notre rapport audit contexte passé, mais sans l'outil de décryptage qu'est notre image. Ainsi, lorsque Proust retrouve le goût de sa célèbre madeleine, un sentiment de bonheur l'envahit, mais sans qu'il sache pourquoi, puisqu'il ne peut replacer son image dans ce contexte émotionnel. Puis, lorsque émerge son image dans le contexte, il se souvient, et peut alors énoncer qu'il s'agit du goût de la madeleine que le dimanche matin sa tante Léonie lui offrait après l'avoir trempé dans son thé. L'impact fut donc le choc provoqué par la réminiscence soudaine de l'émoi oublié. Le souvenir, lui, est en quelque sorte l'entretien de cet émoi par le biais du scénario que nous écrivons au regard de notre image, la conséquence actuelle de l'impact, la trace. Et là, confronté à une ancienne image de nous-même, nous aurions une plus grande latitude d'écriture puisque le miroir n'est plus là pour nous signifier l'écart entre sa réalité et la notre, entre ce que l'on voit et ce qu'on imagine. L'image de soi est donc centrale dans le souvenir (voir l'introduction au débat : L'image de soi - lien - , et aussi : La page blanche - lien - , là où s'écrit l'histoire).
Et comme nous parlons plus spécifiquement des souvenirs d'enfance, de leurs conséquences, plutôt que de leur impact, il me semble justement que les conséquences les plus préjudiciables pour nous en soit leur absence, ou, comme dit précédemment, qu'ils se manifestent sous forme de souvenirs écrans, dont le sens nous échappe, inélaborables, le lien entre la chaine signifiante (le souvenir) et le signifié (l'entre les lignes) étant mal établi. Partant, si le souvenir ne peut advenir, ou inadéquat au regard de notre réalité, c'est donc de l'impossibilité à retrouver de nous même une image regardable, ou qu'elle soit trop floue, c'est-à-dire que l'on ne parvienne pas à percevoir de notre image actuelle son origine, inimaginable, que nous ayons fait disparaitre les précédentes images de soi ayant construit celle que nous délivre à présent le miroir ; cela s'appelle la honte , une honte si profondément incrustée dans le miroir, pour ainsi dire structurelle, qu'elle nous empêche d'accéder à notre histoire (voir l'introduction au débat : La culpabilité - lien - ).
L'emploi du conditionnel, ci avant, comme quoi notre latitude d'écriture du souvenir serait dans l'écart entre l'image que l'on a de soi et celle que nous renvoie le miroir, se justifie par le fait qu'ici, lorsque la honte est « structurelle » (consécutive d'impacts inélaborables), l'image colle en quelque sorte au miroir, comme s'il s'agissait d'un perpétuel combat pour nous approprier ce que nous voyons, un combat où triomphe la honte, laissant de nous une image à sans cesse reconstruire. Alors, notre image est le produit de cette reconstruction permanente, sans restes, sans souvenir cohérent possible, nos réminiscences ne pouvant être contextualisées.
N'ayant plus trop la place de développer, je proposerai pour finir, sans plus, que nous soyons ici dans la dynamique des états limites, où la honte, plutôt que la culpabilité, domine l'économie psychique du sujet. Et puisque, malgré le DSM (outil normatif visant à répertorier nos dérèglements selon leurs symptômes), beaucoup proposent comme caractère principal permettant de révéler les personnalités limites, celui d'une forte propension à la dépendance, nous pourrions y ajouter celui d'un déficit de souvenirs, et notamment d'enfance, là où la honte est la plus difficile à surmonter. En conclusion, je dirais donc qu'impact et souvenir sont antinomiques, sauf par l'absence des dits souvenirs, où, sans l'expérience lisible qu'ils constituent, nous sommes plus exposés aux chocs contingents d'un quotidien alors aléatoire et, par conséquent, où il devient bien difficile de discerner nos nécessités à venir. Bref, si impact des souvenirs il y a, c'est de leur absence.
GG




 bref, son désir, ce qui l'anime. Pour ce faire, la présence du voyeur ne doit pas influencer la scène qu'il observe, choisissant généralement de se dissimuler, quoi que pouvant aussi exploiter le caractère exhibitionniste du (des) protagoniste(s) de l'action. Ce que recherche le voyeur est donc ce qui ne doit pas être vu, ce qui ne peut se voir, ce que l'autre cache, ou ignore, ou n'ose, de son propre désir (voir le texte d'introduction au débat « le désir »
bref, son désir, ce qui l'anime. Pour ce faire, la présence du voyeur ne doit pas influencer la scène qu'il observe, choisissant généralement de se dissimuler, quoi que pouvant aussi exploiter le caractère exhibitionniste du (des) protagoniste(s) de l'action. Ce que recherche le voyeur est donc ce qui ne doit pas être vu, ce qui ne peut se voir, ce que l'autre cache, ou ignore, ou n'ose, de son propre désir (voir le texte d'introduction au débat « le désir » 
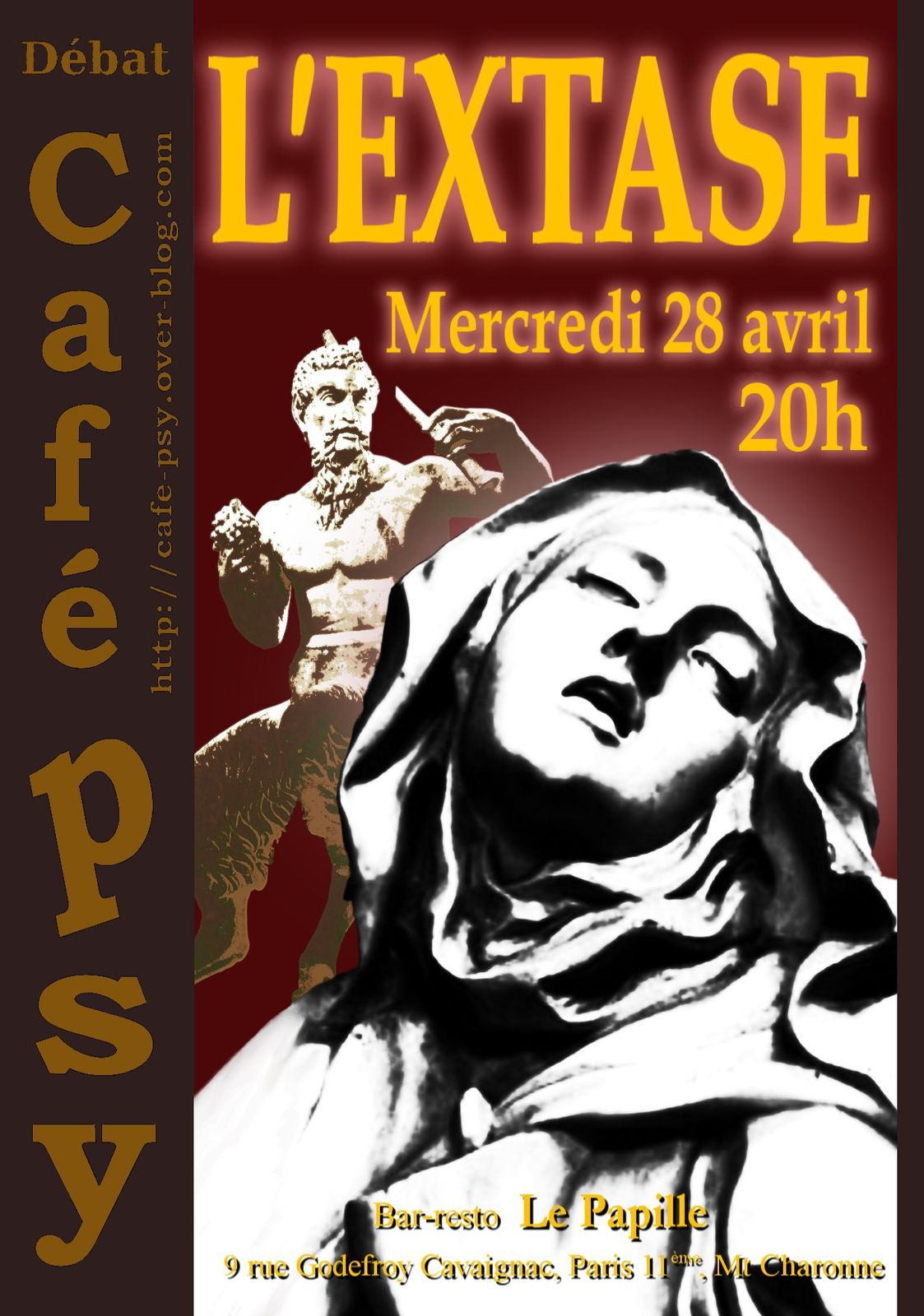
 En chimie, c'est le processus par lequel un corps solide passe directement à l'état gazeux, sans passer par l'état liquide. Au sens commun, la sublimation (le fait de sublimer) et le sublime supposent une élévation spirituelle, esthétique, éthique, et confine donc à une forme d'idéal, ou d'y tendre. Pour la psychanalyse, il s'agit de détourner de son but originel une pulsion sexuelle, ou agressive, en la réorientant vers un but désexualisé et socialement valorisé. Selon Freud (Malaise dans la civilisation), « La sublimation des instincts (entendons pulsions) constitue l'un des traits les plus saillants du développement culturel ; c'est elle qui permet les activités psychiques élevées, scientifiques, artistiques ou idéologiques, de jouer un rôle si important dans la vie des êtres civilisés ». Autrement dit, les grandes et nobles avancées humaines auraient pour moteur la sublimation. Nous sommes là très proche du sens premier accordé au terme sublimation, employé en alchimie pour désigner la transformation d'une matière ordinaire en une autre d'essence supérieure, tel le plomb en or, ou, pour ce qui nous intéresse, le vulgus pécum en pécum nobilis, l'humain standard en un être de progrès. Le mot sublimation est donc un signifiant particulièrement positif, chargé d'une grande valeur morale, l'élévation qu'il sous-tend ne pouvant s'entendre que dans le registre du bien.
En chimie, c'est le processus par lequel un corps solide passe directement à l'état gazeux, sans passer par l'état liquide. Au sens commun, la sublimation (le fait de sublimer) et le sublime supposent une élévation spirituelle, esthétique, éthique, et confine donc à une forme d'idéal, ou d'y tendre. Pour la psychanalyse, il s'agit de détourner de son but originel une pulsion sexuelle, ou agressive, en la réorientant vers un but désexualisé et socialement valorisé. Selon Freud (Malaise dans la civilisation), « La sublimation des instincts (entendons pulsions) constitue l'un des traits les plus saillants du développement culturel ; c'est elle qui permet les activités psychiques élevées, scientifiques, artistiques ou idéologiques, de jouer un rôle si important dans la vie des êtres civilisés ». Autrement dit, les grandes et nobles avancées humaines auraient pour moteur la sublimation. Nous sommes là très proche du sens premier accordé au terme sublimation, employé en alchimie pour désigner la transformation d'une matière ordinaire en une autre d'essence supérieure, tel le plomb en or, ou, pour ce qui nous intéresse, le vulgus pécum en pécum nobilis, l'humain standard en un être de progrès. Le mot sublimation est donc un signifiant particulièrement positif, chargé d'une grande valeur morale, l'élévation qu'il sous-tend ne pouvant s'entendre que dans le registre du bien.


 assertion le message sous-tendu par notre culture, c'est bien l'affirmation de notre culpabilité, chacun devant reprendre à son compte la faute originelle. Evidemment, l'on peut s'interroger quant à ladite faute, justement faute de n'avoir su jusque alors réparer et, peut-être, de voir si malgré tout l'on pourrait faire quelque chose, plutôt que de se transmettre la faute en question de génération en génération. Mais s'agit-il, comme nous l'affirme Freud, du meurtre du père, en l'occurrence celui du fils, le Christ, ou pire, d'avoir carrément tué Dieu ? Après tout, Nietzsche nous a affirmé sa mort, et que nous n'y serions pas étranger. Pour le coup, effectivement, la réparation semble difficile. D'un autre coté, si nous avons réellement tué Dieu, c'est non seulement qu'il y avait nécessité, mais que nous étions les plus forts, et plus fort que Dieu c'est pas rien ! Reste de savoir, au vu des maux que dut supporter l'humanité, telle la religion justement, si l'on ne pouvait considérer le meurtre en question comme de la légitime défense. D'ailleurs, Bakounine nous l'a dit, « si Dieu existait, il faudrait s'en débarrasser ». Toutefois, les Ecritures nous racontent une faute antérieure, organisatrice pourrait-on dire, celle où Eve croqua le fruit défendu qui s'offrait à elle sur l'arbre de la connaissance, accédant ainsi au bien et au mal jusque alors prérogative divine. Nous retrouvons, d'ailleurs, à peu près la même histoire dans la mythologie grecque, celle de Prométhée dérobant le feu à des dieux jaloux de leur savoir afin de le transmettre aux hommes. En somme, la faute originelle est de s'être emparé du savoir, de la connaissance, bref, d'ambitionner la raison, d'oser prétendre à la maitrise du destin, sans même une once de gratitude envers le Créateur, lui, qui justement nous offrit un destin. Luther résume assez bien l'outrecuidance démoniaque d'une telle ambition : « la raison est la putain du diable ».
assertion le message sous-tendu par notre culture, c'est bien l'affirmation de notre culpabilité, chacun devant reprendre à son compte la faute originelle. Evidemment, l'on peut s'interroger quant à ladite faute, justement faute de n'avoir su jusque alors réparer et, peut-être, de voir si malgré tout l'on pourrait faire quelque chose, plutôt que de se transmettre la faute en question de génération en génération. Mais s'agit-il, comme nous l'affirme Freud, du meurtre du père, en l'occurrence celui du fils, le Christ, ou pire, d'avoir carrément tué Dieu ? Après tout, Nietzsche nous a affirmé sa mort, et que nous n'y serions pas étranger. Pour le coup, effectivement, la réparation semble difficile. D'un autre coté, si nous avons réellement tué Dieu, c'est non seulement qu'il y avait nécessité, mais que nous étions les plus forts, et plus fort que Dieu c'est pas rien ! Reste de savoir, au vu des maux que dut supporter l'humanité, telle la religion justement, si l'on ne pouvait considérer le meurtre en question comme de la légitime défense. D'ailleurs, Bakounine nous l'a dit, « si Dieu existait, il faudrait s'en débarrasser ». Toutefois, les Ecritures nous racontent une faute antérieure, organisatrice pourrait-on dire, celle où Eve croqua le fruit défendu qui s'offrait à elle sur l'arbre de la connaissance, accédant ainsi au bien et au mal jusque alors prérogative divine. Nous retrouvons, d'ailleurs, à peu près la même histoire dans la mythologie grecque, celle de Prométhée dérobant le feu à des dieux jaloux de leur savoir afin de le transmettre aux hommes. En somme, la faute originelle est de s'être emparé du savoir, de la connaissance, bref, d'ambitionner la raison, d'oser prétendre à la maitrise du destin, sans même une once de gratitude envers le Créateur, lui, qui justement nous offrit un destin. Luther résume assez bien l'outrecuidance démoniaque d'une telle ambition : « la raison est la putain du diable ».