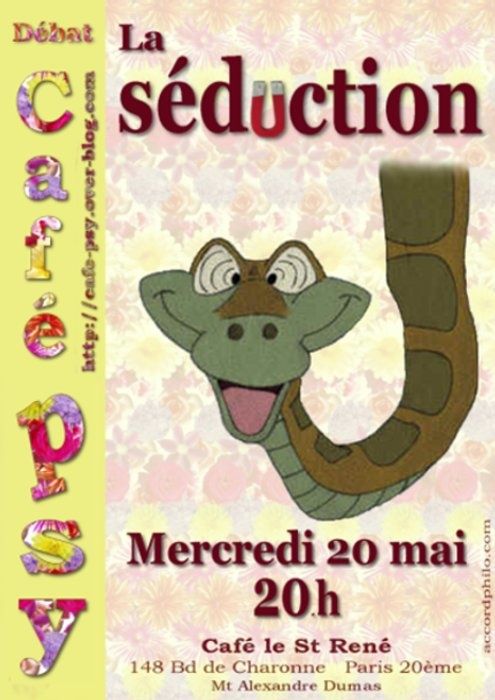L'idée même de confusion, au sens le plus large du terme, induit celle d'apparence plus restrictive de confusion des sentiments, que l'on se pense dans le registre de la raison pure, ou dans celui de l'émotion brute. Le psycho-neurologue américain Antonio Damasio, dans les années quatre-vingt- dix, a démontré l'imbrication de la raison et des sentiments, que toute prise de décision, dite raisonnée, s'élaborait dans un contexte émotionnel. De là, nous pouvons dire que les apprentissages qui nous incitent à la raison ont pour fonction de nous offrir une plus large palette quant aux réponses à apporter à des stimuli émotionnels en provenance de l'extérieur. Par exemple, si le chemin du point A au point B est susceptible de dissimuler un danger subjectivement supputable, la raison nous imposera un détour, raison motivée par la prudence, c'est à dire un sentiment de peur. De la même manière, nombre de choix idéologiques s'appuie sur un sentiment d'injustice, entre autre, l'image que l'on a de soi, forgée dans l'affect, nous imposant de réagir par tel ou tel forme d'engagement selon d'autres processus émotionnels. Alors, pour peu que les sentiments soient confus, la raison risque fort de l'être tout autant, jusqu'à des passages à l'actes irrationnels faisant office de part-excitations contre des sentiments trop violents que la conscience se refuse à prendre en charge, agir pour fuir la confusion.
S'il est un domaine où la raison nous est présentée comme reine, c'est bien la philosophie. Or, à y regarder d'un peu plus près, nous voyons qu'une bonne part de nos philosophes étaient pour le moins limites au regard de la « normalité », beaucoup s'étant constitués des modes relationnels que l'on pourrait qualifier d'étriqués, sinon de pitoyables. Ce que nous appelons raison, en l'occurrence l'éthique du philosophe, est ce qui se trouve à la surface du système perception-conscience, aux limites du moi, à la frontière entre l'intérieur et l'extérieur du sujet, rempart où se constitue la réalité de l'individu, dans le langage. Autrement dit, la raison, la pensée, nous protège des perceptions que l'appareil psychique ne serait pas en mesure de maitriser sans l'apport d'une réponse émotionnelle symbolisable, pensable. Ici, nous pouvons dire que le part-excitation, la rigueur philosophique, se matérialise dans une pensée qui mobilise l'essentiel des forces du philosophe afin d'endiguer l'impétuosité de sentiments risquant de mettre à nu le conflit psychique, la confusion. L'homme de culture, philosophe ou autre, est donc l'illustration du savoir, et de son nécessaire apprentissage, en tant que défense à un conflit émotionnel singulier et intense. Partant, et sans vouloir critiquer la raison pure, il serait bon de garder à l'esprit cette phrase de Winnicott : « La pensée n'est que piège et illusion si l'inconscient n'est pas pris en compte ». En somme, tout concept, pour pertinent qu'il soit, est le fruit d'émotions singulières dont la confusion fut canalisée par un agir réflexif tout autant singulier et dont il convient par conséquent de relativiser la portée universelle. En somme, le philosophe apporte avant tout une réponse à son propre conflit, et je ne vois pas de conflits universels, contrairement à ce qu'en dit une certaine psychanalyse.
Nous sommes tous confrontés à la confusion des sentiments, fruit d'une histoire singulière, à l'impossibilité d'un choix « rationnel » dans tel ou tel situation, ou d'être assailli par des sentiments ambivalents face à cette personne qui, loin de nous laisser indifférents, nous attire et nous inquiète tout à la fois. Ou encore, d'être pris d'une étrange gaité dans de tristes circonstances, etc... D'autre part, l'ambivalence des sentiments fait partie des processus de maturation normaux chez l'enfant, ou l'objet (le sein maternel au stade oral par exemple) est clivé en un bon et un mauvais objet. Par la suite, cette ambivalence sera peu à peu résorbée par soucis de cohérence imaginaire, on ne peut à la fois aimer et haïr. Si tel n'est pas le cas, que l'ambivalence demeure trop prégnante, cela débouchera sur toutes sortes de dérèglements, de la schizophrénie à la jalousie, en passant par des comportements obsessionnels. Mais plus modestement, l'ambivalence se rappelle à nous lorsque par raison, c'est à dire en symbolisant l'affect, s'impose à nous la sortie d'une vision manichéenne où l'objet se doit être reconnu dans sa globalité, dans les sentiments contradictoires qu'il génère. Si cela débouche généralement sur un compromis où l'on fera la part des choses, un tri sentimental pourrait-on dire, une certaine confusion peut néanmoins persister. L'illustration dramatique de cette scène (au sens théâtral donc) est le conflit œdipien où s'oppose principe de plaisir et principe de réalité, le désir et la loi, le compromis pouvant être ici considéré comme la formation du surmoi (secondaire dans une perspective kleinienne), « symptôme » parfois fort invalidant, sadique selon Freud, obscène et féroce selon Lacan.
Toute personnalité se fonde sur du conflit intrapsychique et sur les façons d'y faire face, ou de l'esquiver, mécanismes de défense du moi et autres symptômes. Mais pour qu'il y est conflit, il faut un élément désorganisateur, du réel venant bouleverser notre intime réalité, cela pouvant générer des conflits d'intérêt parmi celles de nos forces chargées d'intégrer sans trop de casse ledit élément. Or, il n'est pas toujours facile de reconnaître les sentiments contradictoires qui résultent de ce conflit, surtout lorsque l'ambivalence présente chez l'enfant ne put trouver à se résoudre dans un compromis satisfaisant pour la psyché, générant par là même des angoisses qui restent à fleur de peau. L'un des moyens pour luter contre la confusion émotionnelle et l'angoisse qui en résulte, est tout simplement d'éjecter les affects hors de la psyché, comme par exemple dans la perversité, en projetant chez l'autre ce qu'il est insupportable de reconnaître en soi, afin de le manipuler à l'extérieur (identification projective). Ces personnes « désaffectés », selon le terme de Joyce Mac Dougall, conduirons les psychanalystes Marty, de M'Uzan et David (1963) à développer le concept de « pensée opératoire », où les mots sont vidés de leur contenu émotionnel, faisant produire à la personne des discours ennuyeux, vidés de leur sens profond, où les mots deviennent des choses impersonnelles puisque dépourvus d'affect. De là, les psychosomaticiens américains Sifneos et Nemiah (1973) développerons le concept attenant « d'alexithymie », dont l'étymologie signifie : sans mot pour le cœur, autrement dit, dans l'impossibilité de nommer un état affectif, de distinguer un sentiment d'un autre, par exemple la colère et la peur, ce qui n'est d'ailleurs pas le cas du pervers précité qui, lui, les reconnaitra, mais à l'extérieur.
Nous voyons donc les nombreux destins possibles de la confusion des sentiments, ainsi que son rôle organisateur dans la personnalité de l'individu. Mais l'alexithymique, qui est celui qui colle au plus près à l'énoncé de notre sujet, se voit non seulement coupé de sa propre réalité psychique, mais aussi de celle de l'autre, car pour reconnaître le sentiment de son semblable, encore faut-il pouvoir le nommer en soi. L'alexithymique reste donc un étranger au monde et, conséquemment, à lui même. Bien sur, ce n'est pas un hasard si le concept d'alexithymie fut créé par des psychosomaticiens, car si l'affect ne peut se frayer un chemin dans l'esprit, dans la pensée, dans un langage qui en permettrait la décharge, c'est alors le corps qui recevra cette charge émotionnelle et la symbolisera à sa manière, pas n'importe où donc, ni n'importe comment, mais d'un mécanisme qui échappe bien évidemment à la conscience, c'est à dire au langage. Outre les multiples symptômes que cette conversion du psychique au somatique implique, il convient d'intégrer dans cette dynamique psychosomatique les manifestations dans l'agir qui ont pour fonction de disperser les affects inaccessibles à la conscience.
L'alexithymique est donc celui qui attaque en lui toutes formes de sentiments, tristes ou gais, sous peine de voir ressurgir une angoisse jamais très loin. Le modèle de cela, où s'enracine le trouble, se trouve dans le rapport affectif que l'enfant entretient avec ses figures d'attachements, particulièrement dans sa relation avec qui détient la fonction maternelle. Le tout jeune enfant, avant qu'il n'accède au langage, peut être considéré alexithymique puisqu'il ne possède pas les mots lui permettant d'exprimer ses sentiments. C'est donc sa mère, ou qui en a la fonction, qui, de part ce que le psychanalyste Wilfred Bion a nommé la « capacité de rêverie maternelle », devra métaboliser en elle la production affective de l'enfant et, de cette transformation, restituer à son chérubin un sentiment déchargé de l'angoisse propre à l'ambivalence. Autrement dit, elle prête son appareil à penser, à rêver, afin de donner du sens aux décharges émotionnelles de son bambin. Toutefois, si la mère ne tolère pas cet état d'empathie, indiquant par là même à son enfant que les sentiments qu'il produit sont source de danger, celui-ci intègrera la nécessité de taire ses affects, car avant tout porteurs d'angoisse. Ainsi, avant même de parler, l'enfant apprend qu'il n'y a pas de mot pour véhiculer, contenir, élaborer, des émotions dont l'ambivalence risque de demeurer en l'état, surtout si le milieu culturel et familial promeut un style relationnel où il convient de taire ses affects pour protéger la cohésion du groupe.
Parmi les multiples conséquences de ce funeste démarrage au sein d'un monde désaffecté, notons l'impossibilité pour l'enfant d'accéder à une réelle autonomie. En effet, comme l'a décrit Winnicott, l'enfant doit intégrer l'image d'une mère protectrice et bienveillante qui, grâce à la confiance qu'elle place en son rejeton, entendons dans la pertinence de la production affective dudit bambin, autorise ce dernier à réaliser ses propres expériences en s'éloignant peu à peu du port d'attache maternel dont la rassurante présence sera matérialisée par un objet transitionnel, le doudou. Or, si en place de la confiance l'enfant reçoit le message que le ressenti émotionnel par lequel il appréhende son image ainsi que le réel environnant est générateur d'angoisse, il ne pourra mettre en scène ses éprouvés affectifs pour construire une réalité dans laquelle il puisse se situer. Aussi, devra t-il rester prêt de maman, ou de toute autre personne qui détient les clefs de cette réalité qu'il ne peut s'approprier au travers de sentiments distincts. Partant, si l'enfant parvient à dépasser l'angoisse de morcellement consécutive à l'ambivalence de sentiments inélaborables, il a toutes les chances de rester coincé à un stade préoedipien avec angoisse de perte d'objet, d'abandon, étant ainsi privé des « joies » œdipienne de l'angoisse ultérieure, dite de castration. La confusion des sentiments, dans sa dimension pathologique, l'alexithymie, concerne donc essentiellement les états limites, entre structures psychotiques, alors dépassées, et structures névrotiques, comme d'un horizon inaccessible.
En commençant cette introduction au débat par l'apport de Damasio établissant un lien irréfutable entre raison et émotion, puis, par l'exemple du philosophe mobilisant sa pensée au travers d'une culture considérable afin de résoudre ses conflits émotionnels, cela concernant plus globalement qui s'astreint à une forte production symbolique, de l'artiste au scientifique, en passant naturellement par le psychanalyste, mon intention était d'insister sur la voie (voix) naturelle par laquelle l'humain est à même d'appréhender ses sentiments, éviter la confusion : le langage. C'est par la parole, l'écrit, la pensée, que nous pouvons vivre en libérant ce qui paradoxalement relève de l'informulable, nos émois. Or, un mot ne se définit pas par lui même, mais par d'autres mots qui eux mêmes appellent de nouvelles définitions, etc, formant ainsi une chaine signifiante qui constitue la richesse dudit mot. Mais pour qu'un mot intègre notre réalité, que se constitue la chaine signifiante, celui-ci est investi de l'image dont nous avons la nécessite de garder trace, et qui dit nécessité, suppose par là même une émotion attenante à l'image, le désir d'avoir à disposition la charge affective qui généra la nécessité d'intégrer l'image en question, une métaphore en somme. La confusion des sentiments émerge donc lorsque le potentiel affectif du mot est éjecté de celui-ci, réduisant d'autant la chaine signifiante afin d'ôter du discours son pouvoir évocateur en terme d'émotion, le langage est dévitalisé, perdant ainsi la capacité d'élaboration de notre vécu, la métaphore est plombée.
Dans tous les cas, il est difficile de cerner le réel du sentiment, et à plus forte raison son ambivalence, c'est à dire de lui donner un sens qui ne paralyse pas le mouvement d'acquisition de notre réalité, qui ne s'oppose pas à notre puissance d'agir put dire Spinoza. Même un sentiment positif nous invitant à une bienheureuse béatitude, du genre rencontré dans un état amoureux par exemple, demande à être élaboré, ne serait-ce que d'accorder les rythmes des désirs en présence. Alors, lorsque il s'agit d'un sentiment pourvoyeur d'angoisse, seule une approche par du langage émotionnellement signifiant nous permet d'en remanier le sens. C'est donc par l'assemblage complexe d'une multitude de chaines signifiantes, des mots, que se tissera le filin à même de déplacer la tranche de réel qui obstrue notre réalité, notre flux désirant, et de poursuivre notre chemin dans un monde sensible qui ne soit plus masqué par un bloc d'angoisse que l'on crut inamovible.
Pour finir, peut-être devrions-nous nous interroger de savoir dans quelle mesure notre modernité favoriserait la confusion des sentiments ? Ainsi, le psychologue JL Pidinielli envisage que la surabondance d'opportunités identificatoires offertes par les médias, télévision, cinéma, soit susceptible d'éloigner certains sujets de leurs propres émotions. Mais plus avant, et peut-être de manière contradictoire, du constat de la perte de nos anciennes valeurs dans leurs formes incarnées par des figures transcendantales, Dieu, l'état, l'éthique idéologique ou philosophique, nous laissant sans ces contenants préformés dans lesquels pouvait s'incarner un ressenti émotionnel facilement partageable, serait-il alors possible que la difficulté devant laquelle se trouve le sujet pour s'inventer de nouveaux contenants ne se référant que de lui même, que donc l'on puisse se perdre dans un labyrinthe émotionnel, à présent non fléché, et dont on ne peut parfois sortir qu'en y déposant le ressenti par lequel nous nous égarâmes ? Mais bon, heureusement il y a les débats du café psy pour remettre du sens dans tout ça !
GG