Merci à tous, qui, pendant cinq ans, par votre participation et vos commentaires, avez permis l'aventure du café psy, mais tout a une fin,
le café psy s’arrête.
Plus tard, peut-être...

Merci à tous, qui, pendant cinq ans, par votre participation et vos commentaires, avez permis l'aventure du café psy, mais tout a une fin,
le café psy s’arrête.
Plus tard, peut-être...
« Le monde bouge », chantait François Béranger dans les années soixante-dix, constatant l'usure du vieux monde et la promesse d'un renouveau aux couleurs soixante-huitardes, où le désir aurait enfin voix au chapitre, et même, ferait force de loi : « le monde se fera sans vous, ou contre vous ! ». Finie la « société disciplinaire » telle que décrite par Michel Foucault, place à l'imagination ! Malheureusement, comme nous l'avions esquissé dans notre précédent débat, l'enfermement, Gilles Deleuze, un peu plus clairvoyant, identifie cette indéniable mutation socio-psycho-anthropologique comme trouvant naissance dans l'après-guerre et remplaçant peu à peu la société disciplinaire par ce qu'il nomme « société de contrôle » (-Lien-). Parallèlement, la psychanalyse aussi constate que le monde bouge, que le modèle psychique jusqu'alors dominant, incarnation de la normalité, celui des structures névrotiques, est progressivement supplanté par les états limites (voire l'introduction au débat : Etats limites -Lien-), et jusqu'à en constater la croissance exponentielle dans les années quatre-vingt et quatre-vingt-dix, notamment grâce à des auteurs tels que Jean Bergeret ou Otto Kernberg.
années soixante-dix, constatant l'usure du vieux monde et la promesse d'un renouveau aux couleurs soixante-huitardes, où le désir aurait enfin voix au chapitre, et même, ferait force de loi : « le monde se fera sans vous, ou contre vous ! ». Finie la « société disciplinaire » telle que décrite par Michel Foucault, place à l'imagination ! Malheureusement, comme nous l'avions esquissé dans notre précédent débat, l'enfermement, Gilles Deleuze, un peu plus clairvoyant, identifie cette indéniable mutation socio-psycho-anthropologique comme trouvant naissance dans l'après-guerre et remplaçant peu à peu la société disciplinaire par ce qu'il nomme « société de contrôle » (-Lien-). Parallèlement, la psychanalyse aussi constate que le monde bouge, que le modèle psychique jusqu'alors dominant, incarnation de la normalité, celui des structures névrotiques, est progressivement supplanté par les états limites (voire l'introduction au débat : Etats limites -Lien-), et jusqu'à en constater la croissance exponentielle dans les années quatre-vingt et quatre-vingt-dix, notamment grâce à des auteurs tels que Jean Bergeret ou Otto Kernberg.
Rappelons que nous sommes tous structurés selon l'un des trois modèles suivants : psychotique, limite, névrotique, même si Bergeret conçoit les états limites comme astructurés, ou encore, la plupart des lacaniens pour qui les états limites n'existent tout simplement pas, préférant s'en tenir au modèle freudo-lacanien : psychotique, pervers, névrotique. Ainsi, en place de ceux que nous appelons états limites, le lacanien JP Lebrun préfère parler de « néo-sujets », sortes de pervers soft dominés par le principe de plaisir. Pour d'autres encore, les états limites s'intègrent à l'une ou l'autre des structures, bien qu'à leurs limites, etc... Quoi qu'il en soi, notre néo-sujet envahi progressivement le champ social et le cabinet des psychanalystes. Mais vu qu'il est plus aisé de se comprendre en sachant d'où on parle, nous postulerons les dits néo-sujets en tant qu'entité structurelle par leur nom d'usage le plus répandu, qui à mon sens colle au plus près de leur (notre) réalité, à savoir, donc, « états limites ». Notons toutefois, puisque les états limites ont pris la place des pervers de l'ancienne nosographie (classification descriptive), que ces derniers se subdivisent en deux organisations psychiques fort différentes, perversité et perversion (voire l'introduction au débat : Pervers narcissiques -Lien-), les deux prenant place dans « le tronc commun des états limites » aux cotés des autres personnalités dites narcissiques, mais pas perverses, ou du moins pas plus que tout un chacun. Donc, état limite ne veut pas dire pervers, bien que ceux-ci y trouvent place. Un dernier petit rappel : aucune structure n'est anormale ou pathologique en soi, les ennuis commencent en cas de décompensation totale ou partielle de la structure, quelle qu'elle soit, et j'insiste, état limite ne signifie pas malade.
Aujourd'hui, donc, l'ensemble des sciences humaines s'accorde à dire qu'effectivement le monde bouge, et cela en profondeur. Et bien que le monde fût de tout temps en mouvement de par ce qu'on pourrait appeler la tectonique culturelle, c'est à présent le psychisme même du corps social qui est en mutation. Le monde occidental contemporain, capitaliste, disciplinaire, de suivre Michel Foucault, s'il émerge donc au début du XVIIIè siècle, notons malgré tout qu'il se fonde sur un ordre symbolique séculaire continuant de véhiculer les valeurs héléno-judéo-chrétiennes qui lui donne en quelque sorte son caractère (en psychanalyse nous parlerions de surmoi, bien qu'en l'occurrence il serrait plus juste de dire « surnous »). Or, au risque de paraître un peu réactionnaires, tous s'accordent à dire, sous diverses formes relatives aux positions épistémologiques de chacun, que la mutation en question est directement corrélée à la perte progressive des valeurs sus-mentionnées. Autrement dit, notre psychisme se modifierait à mesure que s'effriteraient nos valeurs ancestrales. Voilà, ça c'est le constat général qui semble à peu près admis de tous. Toutefois, la nature (humaine) ayant horreur du vide, les avis commencent à diverger pour savoir de quelle manière ce vide symbolique serait éventuellement comblé. Je dis éventuellement, car, pour beaucoup, l'actuel « malaise dans la civilisation » proviendrait justement de ce vide consécutif à l'état de délabrement de notre culture, c'est-à-dire sans nouvelles valeurs émergentes, ce qui me semble à la fois vrai et faux.
Mais parler de perte des valeurs suppose de s'entendre sur de ce qu'est une valeur. C'est à mon sens Wikipédia qui dans les « dictionnaires » courants en donne la définition la plus précise (-Lien-) : « Les valeurs représentent des principes auxquels doivent se conformer les manières d'être et d'agir, ces principes sont ceux qu'une personne ou qu'une collectivité reconnaissent comme idéales et qui rendent désirables et estimables les êtres ou les conduites auxquelles elles sont attribuées. Elles sont appelées à orienter l’action des individus dans une société en fixant des buts, des idéaux. Elles constituent une morale qui donne aux individus les moyens de juger leurs actes et de se construire une éthique personnelle ». On peut donc dire qu'il s'agit d'un système de normes plus ou moins explicites qui offre à chacun de construire son idéal tout en affirmant la cohésion sociale. Toute société est ainsi fondée sur un système de valeurs qui forme la partie visible de sa structure, ou, en d'autres termes, l'esprit de la loi. Quant à savoir par quelles valeurs nous sommes concernés, à savoir héléno-judéo-chrétiennes, elles s'articulent en deux parties, philosophique et théologique (politique et mystique), qui selon les époques laisseront plus de place à l'une ou l'autre partie, mais se confondant malgré tout en une seule et même structure. Ainsi, la partie hellénistique (Grèce ancienne) est celle sur laquelle se fonde, d'une part notre mythologie (Œdipe, Narcisse, Prométhée, etc.), d'abord reprise par les romains, puis adaptée au monde judéo-chrétien, et, d'autre part, c'est de là que vient la philosophie que l'époque médiévale (dès St Augustin) articulera à ses nécessités théologiques monothéistes, fusionnant en une seule et même structure que l'on dira de manière restrictive judéo-chrétienne, notre culture.
Winnicott définit ainsi la culture : « la tradition dont on hérite », donc non seulement un savoir, des valeurs, mais aussi la structure même dudit savoir, c'est-à-dire la transmission de l'ordre symbolique, ce par quoi nous nous comprenons entre les lignes, ce autour de quoi s'articule le discours en enveloppant un fond spécifique reconnu de nos pairs. Quant à la forme, le langage, qu'elle soit composée de mots ou de tout autre symbole, par exemple artistique, elle est l'expression de ce signifié commun que l'on nomme culture. Donc, si nous parlons de valeurs, quant bien même fut-ce de leur perte, c'est alors la structure même du langage qui est ébranlée. Aussi, avant d'en revenir à notre mutation psychosociale pour cause d'effondrement ou de transformation culturelle, intéressons-nous d'abord à là où ça s’exprime : le langage.
Dès qu'il s'agit de langage, donc, nous entrons dans le registre symbolique ; chaque mot est un symbole, c'est-à-dire un élément simple représentant un ensemble complexe. On dit aussi, dans la même logique, qu'il s'agit d'un signifiant, entendu qu'un signifiant renvoie toujours à d'autres signifiants. Cela s'explique du fait qu'un mot se définit par d'autres mots, mais aussi que pour rendre audible notre pensée, nous devons articuler ensemble plusieurs mots. Ainsi, même lorsqu'un tout jeune enfant se contente par exemple de dire « manger ! », nous l'interprétons aussitôt dans sa forme plus achevée : « je veux manger ! ». Pareillement, si nous nous contentons de dire « oui », ou « non », notre réponse contient implicitement l'énoncé de notre interlocuteur. Toujours dans la même logique, comme son nom l'indique, un signifiant signifie, c'est-à-dire qu'il renvoie à une chaîne associative que l'on nomme signifié. C'est cette chaîne associative qui nous intéresse, le signifié, pouvant se décomposer en deux parties qui interagissent entre elles. La première nous est propre, c'est en quelque sorte la mémoire des affects générés par la découverte du mot, affects grâce auxquels le mot est devenu signifiant, nous permettant de le retenir, puis, les affects ultérieurs générés par la nécessité de son usage. La deuxième partie du signifié est culturelle, commune, c'est celle qui permet de nous comprendre au delà du mot, c'est sa définition par d'autres mots, eux-mêmes signifiants. Bien entendu, ces deux parties sont indissociables, sauf pathologie. Mais considérant le peu d'émotions de base (sept selon Darwin), bien que leur intensité variable et leur association nous offre une palette émotionnelle d'une très grande richesse, il nous est malgré tout donné d'associer culturellement un type d'affect à nombre de signifiants. Par exemple, le mot « deuil » suppose de la tristesse, « amour » de la joie, « laideur » du dégoût, etc... Toutefois, cela se complique lorsque nous essayons de communiquer la charge émotionnelle en question, notre ressenti, réel, là où le mot est impuissant, se contentant de guider notre interlocuteur vers ses propres émois, eux aussi réels, et d'espérer en moduler l'intensité afin que ceux-ci s'approchent aux plus près de la chose à communiquer. En sommes, parler, échanger, vise à fusionner les subjectivités en présence dans un espace commun, entre deux, jusqu'à produire un signifié commun, entre les lignes. Ce sera donc la culture, nos valeurs communes, ce que l'on nous à transmis comme signifié attaché au signifiant, qui nous permettra d'établir ces ponts de compréhension, guidés en ça, donc, par du signifié commun. Autrement dit, c'est grâce à une culture commune, représentée par des valeurs communes, que nous nous comprenons au delà du mot. Du coup, s'il y a effondrement des valeurs, il devient bien difficile de communiquer, ce qui semble justement la marque de notre temps, celle des états limites, où les individus se voient de plus en plus isolés, anonymes (voire l'introduction au débat : L'anonymat -Lien-, on ne peut plus complémentaire de notre thème).
Mais donc, la culture, nos valeurs, l'ordre symbolique, tout ça n'est pas sorti d'un quelconque chapeau, mais plutôt le fait de discours transcendants aux rang desquels nous trouvons ceux de la religion et de l'état, représentés par les institutions disciplinaires mises en évidence comme telles par Foucault, églises, écoles, usines, bureaux, etc... Mais la plus importante de ces institutions, je crois, là où s'élabore la structure psychique de l'individu, c'est la famille, bien que le discours familial ne puisse être dissocié de son environnement culturel. Quoi qu'il en soit, il s'agit toujours d'un discours transcendant, ce n'est pas nous qui le produisons, mais une autorité supérieure se chargeant de nous inculquer l'ordre symbolique, la loi, les valeurs. C'est donc cette autorité supérieure, transcendante, qu'on la nomme Dieu, Législateur, l'Autre, ou Père symbolique, qui produit ce qu'on peut alors considérer comme « le discours du maître », c'est-à-dire indiscutable, c'est comme ça, c'est la loi ! Bien entendu, tout discours peut se voir un jour ou l'autre chahuté, même celui-ci, quoique de la pire espèce, celle de l'évidence, du ce qui va de soi, à condition, toutefois, de l'avoir entendu, ou, plus exactement, incorporé, au plus profond, nourrissant notre subjectivité et devenant par là-même le signifié commun, culturel, grâce auquel nous pouvons communiquer au plus proche de nos affects, entre les lignes. Ici, le mot d’incorporation est primordial, car si l’on peut se contenter d’entendre des valeurs, y adhérer ou non, la structure du langage, elle, d’où émanent les dites valeurs, ne peut que s’incorporer de manière autoritaire, une sorte de gavage sous la poussée du discours du maître. Donc, si tout se déroule normalement, nous sommes structurellement gavés au sortir de la période œdipienne (vers six ans, c'est pas à un ou deux ans près). Autrement dit, la structure du langage, l’ordre symbolique, s’intègre à notre structure lorsque nous renonçons à notre toute puissance infantile sous la contrainte de la réalité extérieure, culturelle, le discours du maître.
En psychanalyse on dit que la figure transcendante qui véhicule le discours du maître, la loi, est le Père symbolique, c'est-à-dire l’élément tiers qui s’interpose au nom de la loi entre le désir de l’enfant et celui de sa mère. Freud illustrera cela grâce au mythe d’Œdipe : disons, de manière très succincte, que le père incarne le discours de la loi qui interdit l’inceste entre l’enfant et le parent de sexe opposé, obligeant le bambin à renoncer à son désir et d’aller chercher ailleurs un autre objet d’amour. C’est pour l’enfant le passage du « principe de plaisir » au « principe de réalité » (du « moi idéal » à « l’idéal du moi »). C’est à cette époque que le surmoi de l’enfant (sa morale, plutôt que son désir) devient organisateur, lui permettant de se construire un idéal selon des principes moraux qu’il aura introjecté de ce qu’il aura perçu de l’idéal paternel, sans forcément grand rapport avec la réalité dudit idéal. Ainsi, il est tout à fait possible, par exemple, de se construire un surmoi particulièrement exigeant au regard d’un père réel plutôt laxiste. Par ailleurs, l’influence de l’environnement, familial, culturel, scolaire, n’est pas à négliger, ainsi, bien sur, que la parole maternelle. C’est donc bien du Père symbolique dont nous parlons, pas du père réel, même il s’incarne culturellement dans la figure du mari de maman. D’ailleurs, bien plus que l’interdit de l’inceste qui est universel, nous voyons là l’ordre symbolique de notre culture patriarcale, où c’est l’homme qui incarne le pouvoir, la puissance et la loi, et notamment le père en tant que chef de famille, le pater familias. C’est ainsi que Lacan, jouant sur l’ambiguïté entre le père réel et le Père symbolique, transcendant, à l’image de Dieu, développera le concept de « Nom du Père » en tant que signifiant de base de l’ordre symbolique, de la structure du langage. En deux mots, considérant qu’un signifiant renvoie toujours à d’autres signifiants, nous en arriverons tôt ou tard, de signifiant en signifiant donc, au Nom du Père, c'est-à-dire au symbole maître sur lequel repose la structure, un peu comme l’on dirait, quelle que soit la voie empruntée, « tous les chemins mènent à Rome ». Ou bien encore, demandant quelque explication sur le dire d’un enfant, celui-ci finirait par nous répondre « c’est papa qui l’a dit ! ». Or, lorsque nous parlons d’effritement des valeurs, d’effondrement culturel, cela signifie que le discours du maître n’est plus structurant, qu’il n’imprime plus de signifié culturel dans notre subjectivité, que le Nom du Père n’incarne plus l’ordre symbolique. En somme, l’individu se retrouve seul, anonyme, face à sa quête d’idéal, n'ayant d'autre choix que de demeurer à lui-même son propre idéal.
Bien sur, être à soi même son propre idéal pourrait sembler prometteur en terme de liberté, ce qui d’ailleurs peut être vrai. Toutefois, considérant l’homme en tant qu’animal social évoluant dans le symbolique, le discours du maître est justement l’élément fédérateur qui unit les individus autours de symboles communs représentant à peu près la même chose pour chacun, introduisant ainsi le signifié commun, c'est-à-dire rapprochant les subjectivités en présence. Par ailleurs, entrer dans le symbolique a pour conséquence de se couper du réel : d’une part, un symbole n'est pas la chose en soi, réelle (le mot table, par exemple, n'est pas une table), et, d’autre part, utiliser un symbole suppose donc une interprétation dudit réel, c'est-à-dire dans l’après-coup d’un passage aux filtres de notre subjectivité. Mais le réel, lui, il est toujours là, et il arrive qu’il se rappelle à nous en des chocs que le symbolique n’est pas en mesure d’absorber. Songeons par exemple à la mort, à la douleur, à l’altérité, mais aussi à l’amour… Or, justement, le discours du maître, s’il veut s’imposer comme tel, se doit de fournir une sorte de mode d’emploi afin d’encaisser les chocs en question, avec renvoi au Nom du Père (le signifiant de base). A cet égard, le discours de la religion (quelle qu’elle soit) est exemplaire, sinon caricatural : de la mort à l’amour, au nom du Père, elle explique tout et nous dit comment nous y comporter, n'hésitant pas, en certains cas, à une débauche de symboles en des cérémonies dont la fonction est de réaffirmer le Nom du Père en tant que grand dépositaire du réel. Notons, au passage, que l'église n'est pas la seule à nous imposer ce genre de rites initiatiques, enterrement ou mariage par exemple, et que l'état est ici en forte concurrence. Donc, si nous somme seul, sans cette base de signifié commun, sans pouvoir se référer au Nom du Père, ce n’est pas la liberté qui nous est promise, mais une succession de chocs qu’il nous est impossible d’adoucir symboliquement dans le partage avec nos semblables, et pour cause, puisque de fait ils ne sont pas nos semblables, mais des autres que nous ne comprenons pas, ni qui nous comprennent, sans signifié commun, autant dire des étrangers. Du coup, tel l'enfant pré-œdipien n'ayant pas introjecté le Nom du Père, le discours du maître, nous demeurons sous tutelle maternelle, dans une relation duelle sans tiers séparateur, avec pour conséquence de nous maintenir dans un état de dépendance, coincé dans une sorte de dialectique entre le désir maternel et le notre, où l'autre n'a donc pas sa place. En fait, nous sommes là dans le monde des états limites, où le discours du maître peut être reconnu intellectuellement, mais n'est pas structurant.
Jusque là, donc, selon nos valeurs séculaires, le discours du maître était le fait de la religion et de l'état, relayé par la famille, et s'incarnait dans une figure masculine : le Père. Or, comme l'a souligné Nietzsche, nous avons tué Dieu ; l'état, quant à lui, sensé protéger et s’occuper du bon peuple, est plutôt perçu, aujourd'hui, comme à la solde de la finance ; reste la famille, et là, en place de son traditionnel rôle éducatif, nous voyons des parents incapables d'imposer leur autorité, bien plus soucieux d'être aimés de leur progéniture que de l'éduquer. Nous pouvons aussi ajouter, à mesure que s'installe la société de contrôle, le délitement des institutions disciplinaires de la société du même nom, laissant l'individu face à un objet virtuel, sans nom... bref, comme l'affirme l'adage, « tout fout le camp ! ». Mais, comme dit précédemment, c'est essentiellement dans la famille, selon le modèle culturel œdipien, et surtout patriarcal, que se structure l'individu. Donc, jusque ici, Les choses se passaient ainsi : au début, même si le père est très rapidement perçu par l'enfant, c'est essentiellement la dyade mère-enfant qui constitue son monde. Et donc, nous le savons, de tout temps le monde bouge, peu à peu se fracture ladite dyade, l'enfant s’apercevant alors qu'il n'est pas l'unique objet du désir de sa mère, mais que celle-ci est aussi attirée vers son compagnon, le père, entre autres, en un désir incompréhensible par l'enfant qui n'est pas en âge de saisir la composante sexuelle d'un désir adulte. Ensuite, comme si ça ne suffisait pas, voilà que le père en question, désigné par la mère en tant qu'objet autre de son désir, voilà que celui-ci s'interpose d'autorité lorsque l'enfant (voire la mère) manifeste son mécontentement devant cet état de fait, et rien à faire, pas moyen de négocier, c'est comme ça, c'est la loi, et, selon le principe de réalité, qu'il faille faire avec. Le père (ou qui en a la fonction, ce peut même être la mère) devient donc celui qui impose le prima de la réalité devant celui du désir, endossant par là même l'ordre symbolique auquel renvoie ladite réalité, à savoir le discours du maître. Sauf donc, que le maître en question aurait comme du plomb dans l'aile.
Si changement il y a, il convient donc de s’interroger quant au nouveau discours relayé par un père de plus en plus discret, à moins que tout discours transcendant ait disparu, ce qui ne me semble pas le cas, et qu'il y ait bien de nouvelles valeurs véhiculées par l'air du temps. Disons le mot, même si celui-ci n'est plus très à la mode, bien qu'après tout, dans le genre vieux réac., nous ayons déjà parlé de perte des valeurs, et qu'à présent, toute honte bue, nous nous glissions dans l'ordre symbolique du vieux gaucho, c'est donc du discours capitaliste dont il est question. Si par le passé le discours du maître était celui de Dieu et de l'état, il est à présent celui du capital, ce que nous appelons libéralisme, y compris ultra, n'étant que le versant radical dudit discours. Mais la grande différence entre le discours religieux, ou étatique, et le discours capitaliste, plaçant notre civilisation devant une situation inédite, c'est que, jusqu'alors donc, le discours du maitre consistait en un mode d'emploi visant à cerner le réel par des symboles qui jusque là n'y avaient pas accès, c'est à dire d'apporter des réponses indiscutables, bien que philosophiquement discutées, aux grandes questions existentielles qui taraudent l'humanité depuis la nuit des temps : qui suis-je, où vais-je, dans quel état j'erre, qu'est-ce qu'il y a après, avant, au delà, pourquoi quelque chose au lieu de rien (Leibnitz), étoitéki (surement du grec ancien), etc... Autrement dit, le discours du maître avait pour fonction de placer du symbole là où le symbole ne peut aller, répondant au cœur de la problématique humaine, remontant à la source même du désir, nous donnant l'illusion d'un réel accessible. D'ailleurs, le discours du maître s'incarnait toujours en une figure humaine, sexuée, en l’occurrence masculine, Dieu en étant le prototype, créé à l'image de l'homme, et jusqu'à Papa. Mais le discours capitaliste, lui, n'est pas sexué, ne pouvant s'incarner dans une figure à laquelle on puisse s'identifier, ne contenant rien d'une problématique en terme de désir humain, aucun philosophe pré-capitaliste n'ayant par exemple imaginé le consumérisme en tant que question (ne pas confondre consumérisme et désir, ou envie, ce que le maître Capital aimerait nous faire croire, ou, plus exactement, nous vendre). D'ailleurs, s'il existe nombre d'idéologues du Capital, aucun n'est connu du grand public. Du coup, l'ambiguïté sur laquelle jouait Lacan, entre père réel et Père symbolique, disparaît, le Nom du Père ne pouvant plus être endossé par le père réel ou quelconque figure transcendante. Ainsi disparaît le signifiant de base de notre ordre symbolique. Autrement dit, s'il y a bien de nouvelles valeurs, celles-ci, sans modèle identificatoire, ne sont plus structurantes.
Pour finir, avec la famille d'aujourd'hui, bien qu'il y eut encore beaucoup à dire, notamment d'établir un lien entre ce qui précède et la société de contrôle telle que décrite par Deleuze, ou même qu'il ne soit surement pas dû au hasard que ce dernier, avec Guattari, écrivit « L'Anti-Œdipe » au moment où l'on commençait de pointer le déclin des structures œdipiennes, même si le livre reste discutable, mais soulignant l'impact du champ social, avant celui familial, dans la constitution du sujet... et ceci nous ramenant à la famille. Donc, il n'y a pas si longtemps, cinquante ans au plus, c'est la mère qui la première nommait le père, laissant entendre que son désir ne fut pas exclusivement dédié à son enfant et orientant parfois son regard énamouré en direction du viril personnage sus-mentionné, du moins est-ce ainsi que l'imaginaire social envisageait la réalité conjugale. Mais aujourd'hui, par exemple, lorsque la mère tient son enfant pour la tétée et que son désir manifesta un autre centre d’intérêt, c'est bien plus souvent la télé qui capte son attention, ainsi d'ailleurs que celle du père (aimer c'est regarder ensemble dans la même direction), faisant de cet objet, idéal pour véhiculer le discours capitaliste, le nouveau maître de la réalité, de l'ordre symbolique. D'ailleurs, que pouvait-on imaginer de mieux qu'un écran rempli de choses virtuelles pour faire passer un semblant d'humanité. Malheureusement, nous comprendrons que face à cette boite de tous les possibles, même du capitalisme, il soit difficile de la prendre comme telle en tant que modèle identificatoire. Avec la télé il n'est plus question de cerner le réel, de Nom du Père (sauf bien entendu Derrick, ou Albator), mais d'entretenir l'illusion que la réalité (virtuelle) puisse se plier à notre désir, c'est-à-dire l'inverse de ce qu'auparavant, avec toutes ses imperfections, imposait le discours du maître, structurant, et nous protégeant du réel. En fait, si le père réel demeure, quoique dépossédé de son socle signifiant en tant que base de l'ordre symbolique, de la structure, le Père symbolique, lui, disparaît dans le meuble télévisuel, et qu'il soit alors bien difficile de se construire un idéal (le surmoi) au regard d'une boite dont la fonction n'est plus de cerner le réel, mais de le contourner, de l'ignorer, jusqu'à ce qu'il se rappelle à nous en des chocs inélaborables.
Sans vouloir, ni pouvoir prédire l'avenir, il me semble que nous n'ayons d'autre choix sociétal que l'alternative suivante, celle qui d'ailleurs s'offre à chaque état limite : soit nous restons dans le monde de la dépendance, en quête perpétuelle d'objets transitoires (objet qui doit être constamment renouvelé, contrairement à « l'objet transitionnel » qui finit par être introjecté, formant ce que Winnicott appela métaphoriquement « mère intérieure », à savoir la base de sécurité permettant d'accéder à l'autonomie), et donc plus occupés à chercher une Mère symbolique illusoire (la télé ?) que de nous ouvrir au monde ; soit de s'obliger à la créativité en se donnant les moyens de rejoindre à l'utopie que suppose une société de moi tout puissant déconnectés du réel, contraignant ainsi l'humain d'en appeler à sa nature : l'intelligence, ce qui ne semble pas gagné. Voilà, nous avons commencé avec le titre d'un album de François Béranger, « Le monde bouge », pour en arriver au titre d'un autre de ses albums : « L'alternative », à savoir Big Brother, ou ni Dieu ni maître.
GG
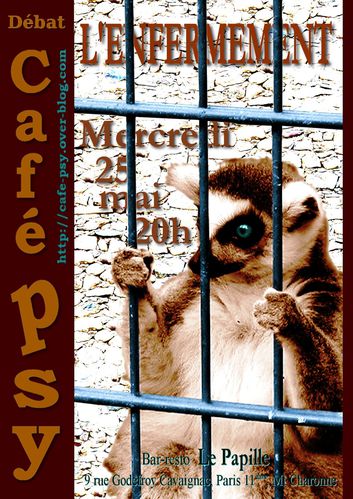
L’enfermement est notre lot… dès le début, dans un utérus, et même avant, dès que l’idée de notre conception germe dans l’esprit de nos parents, nous enfermant dans leur idéal, et même avant, dès que la culture enferma leur idéal. De sorte qu’avant même d’arriver au monde nous sommes pris dans une gangue enserrée d’un désir lui-même enveloppé de civilisation. Dès que nous sommes parlés, pensés, désirés ou redoutés, nous sommes encagés par l’ordre symbolique, le langage, sauf psychose, autisme, ou ce genre de chose. Pourtant, nous autres, gens à peu près normaux, pensons, au contraire, que les dérèglements sus-mentionnés enferment les sujets qui en sont victimes, les condamnant à ce huis clos intime dans ce que l’on dit monde intérieur. En somme, quel qu’on soit, on est enfermé. Juste pouvons-nous relativiser cela par la connaissance des frontières à l’intérieur desquelles nous sommes cantonnés, nous autorisant ainsi à en reculer les limites, augmenter notre puissance d'agir… peut-être (voire l'introduction au débat : Le choix -Lien- ).
Donc, si on prend notre histoire au début, du moins à partir de la vie intra-utérine, seul d’abord existe le réel, à distinguer de la réalité, cette dernière supposant une interprétation, c'est-à-dire passée au filtre de nos représentations préconscientes et autres défenses du moi. Dans le réel en question, que les frontières du corps soient ou non établies, ce qu’il est bien difficile d’affirmer, l’intérieur et l’extérieur sont pris dans un tout duquel le fœtus tire des informations, nourrissant ainsi l’inconscient du futur nourrisson, jusqu’à la formation du moi, à la naissance, un moi précoce, protégeant ainsi ce qu’il convient d’appeler dorénavant « le sujet » de certaines de ces informations potentiellement traumatisantes, « abjectes » selon Julia Kristeva, notamment lors de ce que Otto Rank a nommé « traumatisme de la naissance ». En effet, c’est à la naissance qu’est révélée à l’enfant, entre autre, l’abjection de sa nature mortelle, lorsque, expulsée de son douillet enfermement, sa vie se voit réellement mise en danger par un extérieur froid et hostile, où le corps affronte la pesanteur, où l’air déchire les poumons, désormais dépendant d’un objet extérieur : le sein, objet ambivalent, tout à la fois haï et aimé (voire l'introduction au débat : La haine -Lien- ). Autrement dit, le moi se forme en des défenses destinées à protéger l’être de l’abjection. Mélanie Klein repèrera ainsi, dès le début de notre vie aérienne, « l’identification projective » et « le clivage ». En sorte que le sujet fraîchement libéré est contraint de s’enfermer à nouveau à l’intérieur de défenses qu’il aura lui-même érigées.
J'ouvrirais ici une parenthèse pour dire l'importance de la vie prénatale dans la constitution du psychisme du futur sujet, période durant laquelle, pour ce qui nous intéresse, l'enfermement est on ne peut plus concret. Si nombre de psychanalystes, à commencer par Freud, ont suggéré que la vie intra-utérine pouvait laisser quelque empreinte au niveau d'un « inconscient primaire », certains psychanalystes contemporains, dialoguant avec des sciences voisines, confirment et étayent ce qui jusqu'alors relevait de la simple hypothèse, à savoir que la vie sensible commence dans l'utérus. Partant, il pourrait être utile de concevoir un quatrième stade concernant la psychogenèse du sujet, en fait le premier, avant les stades oral, anal et génital : un stade utérin. Ainsi, le psychanalyste S. Missonnier, conceptualisant une « relation d'objet virtuelle » (ROV) lors de la période utérine, propose de redéfinir l'archaïque en psychanalyse et qu'une place soit accordée « à la relation d'objet virtuelle utérine aux cotés des relations d'objet orale, anale et génitale. » (in Anthropologie du fœtus, sous la direction de J. Bergeret, Dunod, 2006). Allant dans le même sens, Bergeret suppose que l'identification projective, défense visant à un contrôle de l'autre en projetant en lui l'inacceptable en nous, tirerait son origine de traumatismes vécus par le fœtus, insistant ainsi sur l'importance des « traces mnésiques » incrustées lors de ladite période utérine (ibid). De sorte que notre conscience, partie visible du moi, serait le produit de ces premières défenses, et autres ultérieures, visant à reconstituer « une enceinte » autour du sujet, jusqu'à former une structure, sans échappatoires possibles, à l'intérieur de laquelle se déploiera notre personnalité, mais donc limité par la structure en question (voir le tableau concernant les structures de la personnalité à la fin du texte sur les états limites, -Lien- ).
Puis, vient le langage, avec son cortège de lois, l'ordre symbolique, ciment visant à consolider la structure du sujet, jusqu'à la rendre impénétrable. Certes, évoquer l'ordre symbolique en tant que mortier de la structure n'est pas orthodoxe, car parler d'ordre symbolique c'est immanquablement faire référence à Lacan, ce dernier considérant plutôt le langage comme à l'origine de la structure, sinon même la structure en soi. Cela étant, nous savons que la structure du sujet dépendra de fixations, consécutives à un ou plusieurs traumatismes, à certains stades de son développement psycho-affectif. Or, plus la fixation est précoce, moins le langage a de valeur en tant qu'ordre symbolique. En fait, l'ordre symbolique n'a de valeur réellement structurante que pour les structures névrotiques, œdipiennes, ce qui pourrait laisser penser que les autres (états limites et structures psychotiques), la majorité d'entre nous, ont élaboré des défenses suffisamment denses pour que le langage ne soit pas l'élément maître de la structure, quant bien même l'ordre symbolique qu'il sous-tend, la loi, peut en partie être intégré intellectuellement, mais dont la valeur structurante, ou consolidante, ou nulle, dépendra donc du stade d'évolution psycho-affectif auquel se sera fixé le sujet. Quoi qu'il en soit, le langage participe de notre enfermement en tant qu'émanation du désir de l'Autre. En effet, ce n'est pas nous qui l'avons créé, le langage et sa structure relevant des nécessités de ceux qui présidèrent à son élaboration. Ainsi, lorsque peu ou prou nous utilisons le matériau langage pour la construction de notre enceinte privative (participant surement de la « mère intérieure » dont nous parle Winnicott), c'est donc avec le désir de l'Autre que nous nous protégeons, que nous nous enfermons (voire l'introduction au débat : Le désir -Lien- ).
Cela dit, puisque ce sont surtout les structures névrotiques qui sont concernées par l'auto enfermement en question, nous pourrions supposer que les structures psychotiques et limites soient moins soumises au désir de l'Autre, plus libres en somme. Que nenni, car ces dernières relevant de fixations plus précoces, pré-œdipiennes, le sujet demeure dans une dynamique relationnelle fusionnelle ou dépendante, c'est-à-dire soumis par des défenses trop massives à un désir qu'il n'a pu faire sien, mais qui manque cruellement, au risque que l'édifice ne s'effondre. Du coup, nos structures pré-œdipiennes doivent-elles constamment en appeler au désir de l'Autre pour étayer ou colmater leur défenses, mais laissant ledit désir étranger à l'extérieur, comme de cerner une forteresse à la fois imposante et fragile, enfermant alors le sujet dans une sorte de double palissade. Bien entendu, notre sujet peut aussi bétonner tout ça de l'intérieur, se fermant radicalement à l'Autre, le langage perdant alors tout ou partie de sa valeur symbolique, comme dans le cas de psychoses avérées, ou d'autisme, mais aussi lors de la construction d'un faux soi.
Et puis, toujours au rayon langage, quelle que soit notre structure, dès que nous sommes parlés, pensés, nommés, l'autre nous enferme alors dans sa réalité, c'est-à-dire dans ce qu'il perçoit de signifiant en nous, ce qui est forcément différent de notre réel. Notons que l'autre en question nous définissant par le langage, c'est donc du désir de l'Autre qu'il nous habille, et que si ledit désir ne fait pas partie de notre structure, il nous enferme alors dans du signifié hors de notre réalité. D'ailleurs, dès que nous quittons le réel, là où rien ne manque, pour accéder à la réalité, à la conscience, nous somme de fait enfermés puisque cette dernière est le produit d'une interprétation, donc dans un après coup où nous trions inconsciemment des éléments qui selon notre sensibilité cerneront au mieux les affects provoqués par la tranche de réel qui nous a interpellé, mais produisant alors des restes éjectés de notre réalité. Autrement dit, tout ce qui procède de la réalité, du conscient, nous enferme dans des stéréotypes culturels, fruits du désir de l'Autre. Songeons par exemple aux stéréotypes associés à notre genre, masculin ou féminin, où, comme nous l'avions vu dans un précédent débat sur « l'identité sexuelle » (-Lien-), lesdits stéréotypes n'ont que peu à voir avec notre réel, les différences entre fille et garçon étant plutôt minimes (au plan cognitif s'entend). Par contre, ce que tendent à démontrer les études réalisées sur la question, c'est une indéniable réalité opérante des dits stéréotypes, prédictive, chacun ayant tendance à s'y conformer à fin de meilleure communication. Autrement dit, pour avoir une existence sociale, y être reconnus, nous sommes amenés à nous conformer à des rôles culturellement déterminés.
Evidemment, pour échapper à toutes ces formes d'enfermement, rien ne nous empêche de cultiver un jardin secret pour s'ébattre hors de la contrainte sociale, sauf que, bien entendu, ledit jardin demeure notre réalité, et sûrement plus encore que la réalité partagée avec nos plus ou moins semblables, un jardin bien protégé, fermé de toute part, protégeant quelque recoin secret propre à notre structure : un enclos dans l'enclos. En somme, quel que soit le bout par lequel on aborde la question, nous somme prisonniers de la réalité, celle dont nous construisons des contours dictés par un désir étranger, l'Autre que nous avons fait entrer en nous ; comme l'a dit Rimbaud « je est un autre », un autre que l'on pressent dès qu'acculés à la connerie nous prononçons cette phrase aussi vielle que la réalité : « c'est plus fort que moi ! ». Mais le réel aussi nous enferme, celui pour nous d'un monde fini, avec un début et une fin, pris dans une temporalité « abjecte », celle où la vie finit toujours par s'épuiser. Il y a aussi le corps, qui, après avoir fait éclore notre esprit, en limite les ambitions qui le dépasse, bien trop lourd pour un inconscient qui ignore la contrainte, etc...
Et comme s'il ne suffisait pas que nous nous enfermions nous même afin de nous protéger d'un extérieur regorgeant de dangers, bien réels, mais aussi de certaines réalités de certains autres, incompatibles avec la notre, nous efforçant alors de déceler l’ennemi par delà nos murailles, il se peut que l’ennemi en question, que l'on n’a pas vu venir, nous jugeant inadéquats à sa réalité, celui-ci, en nombre, nous enferme dans une prison, ou un hôpital psychiatrique. Pourtant, comme nous l'a enseigné Pierre Desproges, l'ennemi est un imbécile, à ce titre facile à repérer : « il croit que c'est nous l'ennemi, alors que c'est lui ». Comme quoi, il y a bien des réalités incompatibles dont il convient de se protéger.
Il semble donc difficile de parler d'enfermement sans parler de la contrainte par corps, c'est-à-dire lorsque des représentants de la communauté, juges, policiers, psychiatres, estiment en notre nom (notre réalité) qu'un tel doit être tenu à l'écart de l'espace public, s'agissant alors de le protéger, ou de le sanctionner, au vu de sa mauvaise appréciation d'une réalité commune à laquelle il n'est pas permis de déroger. Bien entendu, ladite réalité sera différente selon l'époque, la civilisation, ou la culture dominante, c'est-à-dire, toujours, selon le désir de l'Autre. L'enfermement, en quelque sorte préventif, est d'ailleurs peu à peu devenu la norme de notre société, identifiée par Michel Foucault comme « société disciplinaire », contraignant physiquement et mentalement l'individu dans ses institutions : école, armée, usine, hôpital, famille, et, bien entendu, prison. Mais cette société a un début, prenant son essor au XVIIIè siècle, et, par conséquent, comme toute société, une fin. Cette fin, que pressentait Foucault, suppose donc un renouveau, une nouvelle société, un nouvel ordre, symbolique comme il se doit, et cette nouvelle réalité, où l'enfermement change de forme, Deleuze la nommera « société de contrôle) (1). Nous sommes donc en pleine mutation, passant d'un ordre agonisant qui s'accroche à ses paradigmes disciplinaires en passe d'obsolescence (jamais les prisons n'ont été aussi pleines, alors que l'école, l’hôpital, la famille, tout ça se délite), évoluant à présent vers un ordre nouveau visant au contrôle des individus par le profit, où chacun est placé dans une position instable, fluctuante, l'individu se devant d'être plus mobile que son voisin et, bien sur, en faire montre. Ainsi, l'école, par exemple, est peu à peu remplacée par des formations continues, les postes de travail et le travail lui même étant susceptibles d'être modifiés n'importe quand, l'individu étant alors contraint de se plier à un contrôle continu où il devra démontrer qu'il est plus performant, plus souple, plus malléable que le voisin et, par conséquent, qu'il mérite plus. Les nouvelles valeurs ne sont plus le produit du travail, mais le profit, selon que nous sommes plus ou moins bon élève, contrôlé et certifié comme tel. L'avenir n'est plus à la contrainte par corps, mais à une surveillance continue, le terme contrôle étant dorénavant à entendre comme manipulation.
Si jusqu’alors le désir de l'Autre nous pénétrait dans des espaces clos, il aspire à présent à nous contrôler, sans qu'il soit besoin de murs, il lui suffit de nous empêcher de l'intégrer à nos défenses (la double palissade évoquée plus haut), ce qui tend à devenir la norme, le modèle psychique contemporain, celui des états limites. Bref, l'enfermement a encore de beaux jours, radieux même...
GG
(1) En lien, le texte de Deleuze : « -Post-scriptum sur les sociétés de controle- ». Ce texte, d'une remarquable acuité, mérite vraiment ledétour. On s'y croirait !
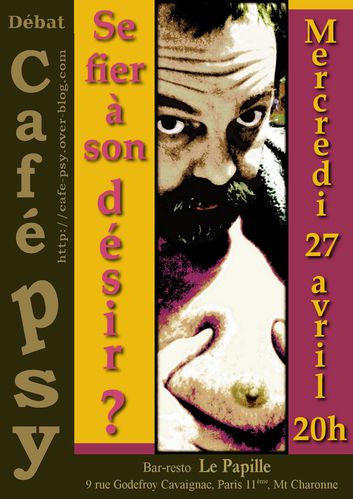
La notion même de désir étant quasiment impossible à cerner, nous ne parlerons là que de désir conscient, de nos envies en somme, et de comment les apprécier. Certes, lesdites envies ne parviennent pas à notre conscience par l’opération du Saint Esprit, ou sous forme de générations spontanées (pas d’effet sans cause), mais puisqu’il est question de s’y fier ou non, que ceci est affaire d’appréciation, donc de langage, c’est bien de notre conscience dont il est question. (Pour une approche un peu plus large du désir, voire l’introduction au débat : Le désir, -Lien-)
Mais que veut dire « se fier à son désir », est-ce dans l'esprit de s'autoriser à y succomber, ou de suivre une intuition ? Serait-ce de céder à une envie, ou qu’il soit simplement question de se faire confiance, pressentant de nous une possible union du plaisir et de la réalité, imaginant que le désir pu rejoindre une certaine forme d’intelligence, comme s’il fut le produit d’un « raisonnement » inconscient visant à extraire de la réalité les outils permettant de façonner dans la joie la résolution d’un besoin qui nous titille ? Quoi qu’il en soit, « se fier » c’est faire confiance, supposant donc, comme on dit, que notre désir en soit digne. Pourtant, le propre de la morale, de l’éthique, de la loi, c’est justement de « civiliser » nos pulsions, notre désir, afin de vivre ensemble autour de compromis acceptables, où le désir du voisin (souvent indigne) n’empiéta pas trop sur notre espace vital, et réciproquement. D’ailleurs, le propre de la civilisation c’est ça : créer de l’interdit autour des zones sombres du désir. En somme, comme nous l’a enseigné la religion, il conviendrait d’être des plus circonspects à l’endroit du désir et, surtout, à son envers, là où se niche le péché, et qu’il soit alors bien difficile de lui faire confiance, de se faire confiance. Evidemment, un esprit tendancieux pourrait laisser entendre que l’interdit en question étant le fait du législateur, que ce dernier privilégia son désir au détriment de celui de l’administré, que le berger s’intéressa bien plus à ses priorités de berger qu’il ne fit cas de son troupeau. Cela étant, si doute il y a, se fier à son désir, et non pas aux préceptes qui en commandent l'usage, reviendrait à être soi-même son propre législateur, culbutant au passage la civilisation qui nous enseigna tant la prudence que l'abord du désir, nous laissant donc bien seul avec toutes ces pulsions qui poussent au portillon d’une conscience civilisée à son corps défendant par le langage de l’Autre, notre culture.
Bien entendu, si la question se pose de se fier à son désir, ce n’est pas du tout venant dont nous parlons, mais d’un désir lourd de conséquences, à commencer par ce qu’il implique en terme d’image de soi, de culpabilité ou de honte, d’émancipation aussi, de gain de liberté. Partant, si de se fier à son désir peut être libérateur, augmenter notre puissance d’agir, il est aussi susceptible de nous tromper, de nous précipiter dans quelque égarement, autant dire qu'alors nous nous tromperions nous-même. A cet égard, songeons à cette tendance, dite compulsion de répétition, de nous replacer systématiquement dans le même genre de situations délétères, guidés en ça par un désir insatiable, trompés dans sa forme par une mauvaise perception de nos nécessités, ce qui, au passage, n'a rien à voir avec la pulsion de mort. A qui se fier alors, je vous le demande ? Ne reste plus qu’un retour à l’Autre, au législateur, à la civilisation, aux codes visant au bon usage du désir, malgré ce que l’on sait de potentiel pervers à toute civilisation, autrement dit au désir de l’Autre, celui la même qui nous façonna, que l’on porte en soi. Du coup, nous voila sans base stable pour estimer le bien fondé d’un désir que l’on souhaita pur, alors qu’il porte en lui l’empreinte du désir de l’Autre, désir dont on souhaiterait s'absoudre, ce qui pourrait définir l’actuel malaise de notre civilisation, où le narcissisme de l’individu est mis à rude épreuve (voire aussi notre précédent débat : L’anonymat -Lien-). Pourtant, si intelligence du désir il y a, c’est d’avoir retenu de notre expérience la solution la plus plaisante pour résoudre un besoin, une pulsion en somme, le désir étant d’y associer une stratégie au regard d’une situation actuelle. Reste qu'une bonne stratégie dépend tout à la fois d'une bonne lecture de la situation, de l'expérience du terrain, mais aussi d'un savoir théorique prenant en considération l'histoire même de la stratégie, c'est-à-dire l'expérience de l'Autre. C'est comme une partie d'échec, où il faut à la fois être en mesure d'apprécier la situation, avoir une bonne expérience du jeu, mais aussi connaître une multitude de positions... et la créativité suivra... où dès lors on peut se faire confiance.
Mais qu’en était-il avant la civilisation, en ces temps archaïques où les humains vivaient ensemble sans le soutien du législateur ? Quoiqu’aux dires de certains, la horde eut déjà un chef. Mais encore avant, avant le chef, avant le Père de la horde, est-il possible d’imaginer un temps où le désir de l’individu, peut-être pré-humain, ne fut pas soumis à quelconque ordre ou hiérarchie, un temps où le désir s’exprima librement, seulement contraint par le réel, hors morale, hors éthique, hors la loi en somme, et pour cause, le législateur n’étant pas encore passé par là. Pourtant, ce temps, nous le connaissons, c’est celui de la petite enfance, avant que le Père de la horde ne vienne faire obstacle au désir de l’enfant en y opposant l’ordre symbolique, le langage de la loi, la réalité, la civilisation, la culture, là où existe de l’autre, avec ses désirs inquiétants. Au début, évidemment, la question de se fier à son désir n’existe pas, puisqu’il s’agit d’un jugement de valeur, la seule appréciation intéressant le tout jeune enfant étant d’intégrer ce qui fonctionne ou non, et d’agir en conséquence. On dit que l’enfant en question, pré-œdipien, est mu par le « principe de plaisir », étant à lui-même son propre idéal (hors le désir du législateur). Par la suite, lors de la période œdipienne, il intégrera le « principe de réalité », c’est-à-dire la présence d’un tiers en tant que prescripteur de la loi (le père symbolique). Ainsi, ce qu’on entend par « réalité » (dans « principe de réalité ») est le discours transcendant qui s’impose au sujet en tant que loi, et qui constitue les valeurs structurant tant l’individu que le clan. Pour autant, nous voyons que la réalité, au sens courant, n’attend pas la période œdipienne pour s’imposer à l’enfant, celui-ci apprenant très tôt à gérer pour son compte ce qu’il comprend du désir maternel. De la même manière, le père réel est présent dès le début dans la vie de l’enfant. Quant au langage, l’ordre symbolique, là où se sépare réel et réalité, il faut évidemment en acquérir une certaine maîtrise pour s’approprier la loi, quant bien même fut-elle implicite, ce que l'enfant acquiert là aussi relativement tôt. Il y a donc une réalité pré-œdipienne, où le sujet privilégie son désir plutôt que les codes régissant le bon usage dudit désir, et une réalité œdipienne, où le sujet se structure dans le discours de l’Autre, faisant sien l’ordre symbolique (passant du « moi idéal » à « l'idéal du moi »). Ainsi, la manière dont nous appréhendons notre désir dépend-elle de la réalité dans laquelle chacun s’inscrit. Peut-être, alors, que nos hommes « pré-civilisés », si tant est qu’ils aient existé, échappaient à « l’ordre œdipien », ce qui remettrait sérieusement en question l’universalité de l'œdipe, ainsi que notre mythologie religieuse. Mais bon, on n’y était pas, juste savons-nous qu’aujourd’hui de plus en plus de monde échappe à cette réalité œdipienne, bien qu’elle demeure le fondement de notre culture.
Tout le problème, en fait, vient de là, car l’individu pré-œdipien vit en quelque sorte dans une culture étrangère (œdipienne), et même s’il en connaît les préceptes, même s’il en parle la langue, ses valeurs sont ailleurs, dans le principe de plaisir, seul avec lui-même, et là, forcément, n’ayant d’autre choix que d’intégrer sa culture d’adoption (la réalité œdipienne), ça coince, le doute s’installe, tiraillé entre deux mondes : « plaisir » et « réalité ». C’est un peu comme de vivre dans un pays dont la langue n’est pas notre langue maternelle : on peut la maîtriser, et même en comprendre les subtilités, il n’en demeure pas moins que ce n’est pas elle qui nous a structuré. Or, la forme de notre désir, c’est-à-dire la stratégie nous étant la plus naturelle pour atteindre au plaisir, dépend évidement de notre structure.
Nous avons donc, d’un coté, les structures œdipiennes, dites « névrotiques », et, de l’autre coté, les structures pré-œdipiennes, dites « limites » et « psychotiques », chacune appréhendant le désir différemment, mais devant se soumettre à un seul modèle a priori fédérateur, comme il se doit œdipien. Rappelons qu’il y a pathologie en cas de décompensation de la structure, mais tant que la structure tient bon, ce qui est le cas pour la majorité d’entre nous, l’individu est normal, même si la frontière entre le normal et le pathologique est on ne peut plus floue ; autrement dit, structure névrotique ne veut pas dire névrose, structure psychotique ne veut pas dire psychose, et état limite ne veut pas dire trouble limite de la personnalité. Cette remarque n’est pas innocente, car, pour beaucoup, le modèle névrotique (œdipien) fait office de norme, allant jusqu’à énoncer cette absurdité que nous soyons tous plus ou moins névrosés, et rangeant les autres, pourtant adaptés à leurs structures, du coté des pathologies avérées. En somme, tout désir n’étant pas structuré par l'ordre œdipien est suspect, sinon anormal. Ainsi, outre le fait qu’une structure limite soit seule face à son désir (étant dans sa structure son propre législateur), notre culture lui renvoie l’image d’un désir inapproprié : il y a de quoi douter. D’ailleurs, la psychanalyse n’est pas étrangère à cet état de fait, réservant les mécanismes de défense les plus adaptatifs aux structures névrotiques, tel la sublimation, par exemple, pour ce qui relève de la création, alors que nombre de grands créateurs, de toute évidence, ne relèvent pas d’une structure œdipienne, la sublimation n’ayant par conséquent rien à voir dans cette histoire (voire l’introduction au débat : La sublimation -Lien-).
Pour résumer, nous évoluons dans une société, une culture, œdipiennes, dont le standard est les structures névrotiques. D'ailleurs, Freud a fondé la psychanalyse sur ledit modèle névrotique, posant l'œdipe comme un universel à atteindre en matière de développement psycho-affectif. Toutefois, si à l’époque de Freud le modèle névrotique fut probablement le plus répandu (voire pour cela les hystériques de Charcot), il en est tout autrement aujourd’hui, les « états limites » l’ayant largement supplanté (voire l’introduction au débat : Etats limites -Lien-). Or, ce qui différencie les structures névrotiques des états limites, pour ce qui nous intéresse, c’est de quelle manière est intégré le discours de l’Autre en tant que vérité transcendante : la loi. Pour illustrer cela, Freud a utilisé le mythe d’Œdipe, faisant de l’interdit de l’inceste la loi qui structure le sujet, et qui, rien de moins, fonde notre culture. Pourtant, œdipien ou non, chacun connait et respecte ladite loi, la différence étant que pour les uns (œdipiens) elle est ce par quoi se structure le sujet, et donc à même d'orienter naturellement son désir vers un autre objet que le parent de sexe opposé, ouvrant le sujet à la conquête du monde, alors que le sujet pré-œdipien, lui, reconnaît ladite loi en quelque sorte intellectuellement, contraint par le milieu, la culture, la loi, mais son désir demeurant structuré par une rassurante relation de dépendance à la mère, et même fusionnelle pour les structures psychotiques. Du coup, même si chacun connait et respecte la loi, nous comprendrons que lorsque s'expriment les désirs de tout ce beau monde, sur le fond, tous ne parlent pas la même langue, ce qui, outre des difficultés de compréhension (entre les lignes s'entend), oblige le sujet pré-œdipien à une permanente remise en question de son désir au regard de la loi et de ses congénères, le maintenant par conséquent dans une dynamique de doute, à moins de croire en sa toute puissance.
Bien sur, il n'est pas question de dire qu'une structure névrotique est protégée du doute, à moins d'être complètement abrutie, juste le doute n'est pas en quelque sorte structurel. Pareillement, un état limite ne passe pas forcément son temps dans les affres de flottements existentiels, bien que le doute fasse partie de sa nature, mais que celui-ci puisse être appréhendé comme un jeu subtil et enrichissant, et ce pour tout le monde. Les soucis surgiraient plutôt du doute associé à une mauvaise image de soi, ce contre quoi doit lutter en permanence l'état limite, beaucoup plus soumis à la honte qu'à la culpabilité (voire l'introduction au débat : La culpabilité -Lien-). Toutefois, en matière de loi transcendante et structurante, à l'instar du mythe d'Œdipe, songeons à celui de Prométhée, équivalant dans la mythologie chrétienne à celui d'Eve mangeant le fruit défendu cueilli sur l'arbre de la connaissance, où donc un humain s'empare du savoir des dieux et est condamné pour ce larcin sacrilège à d'interminables souffrances, comme quoi l'humain doit rester à sa place, ignorant et docile, brebis parmi les brebis, sous peine d'affronter la colère des dieux, le légitime et cruel courroux de l'Autre : le grand Législateur, qui n'est pas du genre à rigoler. Ce précepte du « chacun sa place », et le troupeau sera bien gardé, fait indéniablement partie des lois transcendantes fondatrices de notre culture, mais là, pour le coup, notre état limite s'autorisera bien plus facilement à la transgression, si le doute consécutif de sa mauvaise image ne le paralyse pas trop, alors qu'une structure névrotique, pour qui la loi fait partie de sa réalité surmoïque, aura bien plus de difficultés à en négocier le contournement. Partant, si le mythe d'Œdipe permet au sujet œdipien de s'ouvrir au monde, celui de Prométhée l'enchaine à sa condition. Inversement, si le refus d'Œdipe maintient notre état limite dans la dépendance, c'est la transgression de Prométhée, naturelle à son moi idéal, sauf à trop douter, qui l'autorise à la conquête du savoir et, par là-même, à celle du monde. Il est alors tentant de s'interroger, lequel du sujet œdipien ou prométhéen, est le mieux armé pour s'ouvrir au monde ? même si les champs concernés sont différents, l'un privilégiant la chair, et l'autre... la chaire. En fait, tout dépendra de l'image de soi (voire l'introduction au débat : L'image de soi -Lien-), se fier à son désir étant intimement lié à la construction de notre image et, par là même, de ce qu'on estimera de notre capacité de stratège.
Pour finir, j'en reviendrais au début, où la formulation « se fier à son désir » me semble tout de même relever d'une confusion entre désir et intuition, comme si le désir fut de solutionner un problème, supposant alors ledit désir comme porteur de vérité, en écho à la toute puissance du sujet, comme s'il fut insupportable que notre désir ne soit pas force de loi, légitimant ainsi d'éventuelles transgressions... Bref, Prométhée a encore de beaux jours devant lui, quelques souffrances aussi, ainsi que nos amis pervers. Et n'oublions pas cette profonde parole de Pierre Desproges, grand Autre s'il en est, à prononcer à haute et intelligible voix afin d'en bien saisir les subtiles nuances : « le doute m'habite ! »...
GG
Etre anonyme, étymologiquement, c'est être sans nom,  privé du symbole par lequel nous sommes directement identifiable et inscrit dans l'histoire, une histoire dont nous ne sommes d'ailleurs qu'un fragment, puisque notre nom nous préexiste et qu'à priori nous sommes appelés à le transmettre, du moins concernant le nom de famille. Quant à notre prénom, qui lui nous singularise, il incarne néanmoins le désir de nos parents (ce n'est pas nous qui l'avons choisi). Finalement, avoir un nom, ne pas être anonyme, c'est être inscrit dans le désir de l'autre. Pourtant, aux temps anciens, lorsque se généralisa l'usage du nom de famille, si celui-ci pouvait être associé au prénom du père, il pouvait tout aussi bien désigner un lieu d'origine, une fonction, ou encore une particularité physique ou psychique (Couturier, Leborgne et, bien sur, Dugland), c'est-à-dire fixant le sujet dans sa singularité, et non pas, comme par la suite, dans une histoire qui le dépasse largement.
privé du symbole par lequel nous sommes directement identifiable et inscrit dans l'histoire, une histoire dont nous ne sommes d'ailleurs qu'un fragment, puisque notre nom nous préexiste et qu'à priori nous sommes appelés à le transmettre, du moins concernant le nom de famille. Quant à notre prénom, qui lui nous singularise, il incarne néanmoins le désir de nos parents (ce n'est pas nous qui l'avons choisi). Finalement, avoir un nom, ne pas être anonyme, c'est être inscrit dans le désir de l'autre. Pourtant, aux temps anciens, lorsque se généralisa l'usage du nom de famille, si celui-ci pouvait être associé au prénom du père, il pouvait tout aussi bien désigner un lieu d'origine, une fonction, ou encore une particularité physique ou psychique (Couturier, Leborgne et, bien sur, Dugland), c'est-à-dire fixant le sujet dans sa singularité, et non pas, comme par la suite, dans une histoire qui le dépasse largement.
Puis, vint le temps du fichage... d'abord par l'église, grâce aux registres de baptême et de mariage, permettant à l'institution religieuse de comptabiliser ses ouailles, de les suivre, et par là même de les contrôler, le nom étant à présent gravé dans le marbre de la loi. Plus tard, l'ordre matérialiste prenant le pas sur celui mystique, le registre d'état civil institué par François 1er, mais laissé aux mains de l'église, passe sous la houlette de l'état dans les relents d'une révolution française pressée de nouvelles lois, d'un nouvel ordre, le nom étant désormais celui du citoyen, avec ses droits et ses devoirs... les maitres changent, la loi demeure.
Nous autres, et donc à présent citoyens, évoluant dans une société patriarcale, le nom du père s'imposa pour signifier notre filiation, d'ailleurs bien plus à l'ordre symbolique, à la loi, qu'à une famille réelle dont le nom incarne avant tout le désir du législateur. Ainsi, disant que notre nom est le signe du désir de l'Autre, son symbole, la majuscule s'impose en ce que l'Autre n'est pas seulement nos parents, mais aussi celui qui souhaita leur donner un nom et les inscrire dans une histoire commune ayant pour cadre le désir (la loi) du « Père », du prescripteur, du grand ordonnateur, qu'il se nomme Dieu, Assemblée Nationale, ou air du temps. Partant, être anonyme, c'est être hors la loi.
La nécessité de porter le nom du père, en tant que signifiant de la loi, était particulièrement flagrante lorsque, il y a peu encore, les enfants nés de père inconnu étaient contraints au seul nom de la mère, désignés alors en tant que « bâtard » et placés en marge de la société. Certes, ceux que l'on avait aussi coutume d'appeler, avec un peu plus de réserve, « les enfants du péché », n'ont pas eu à attendre le registre d'état civil pour être honnis socialement, ce n'est pas le nom qui fait la loi, il n'en est que le symbole, mais l'on voit ici de quelle manière il n'est pas besoin de connaître l'histoire du sujet pour d'emblée le condamner, puisque de par son nom il est déjà fiché comme tel. En somme, jusqu'à peu près aux années soixante, le nom de la mère, en nous excluant du désir de l'Autre, sauf peut-être celui de maman, nous frappait d'indignité, alors que le nom d'un père éventuellement fictif nous ouvrait les barrières du champ social. Du coup, je me demande si l'on peut attribuer au hasard que ce soit justement à cette époque des prémisses d'une libéralisation des mœurs, fin des années cinquante, que Lacan développa le concept de « Nom du Père » en tant que métaphore opérante (j'y reviendrais), lui qui souffrit de ne pouvoir transmettre son nom à la fille qu'il eut avec la femme de Georges Bataille, validant ainsi et à jamais sa culpabilité.
Donc, après cet extrait de la gazette des potins psychanalytiques, je crois que cette ancienne place du nom de la mère comme désignant le sujet hors la loi, soulève l'ambiguïté de l'anonymat. En effet, il y a à priori deux façons de vivre l'anonymat, choisie, ou subie, soit on se sépare volontairement de son nom, soit on nous en prive. Or, nombre de gens dûment nommés, certificats et pièces d'identité à l'appui, se considèrent pourtant anonymes, alors qu'à l'opposé il est possible de se révéler dans toute sa splendeur au travers d'un pseudonyme, notamment sur Internet, entendu que même avec notre véritable nom on demeure toujours inconnu à l'autre, ne serait-ce que de l'inaccessibilité de notre inconscient, et je ne parle pas de toutes les petites et grosses bassesses, et autres imperfections, que l'on préfère garder par devers soi. Donc, le contraire de l'anonymat n'est pas d'être connu, mais reconnu. Ajoutons que le hors la loi patenté, nommé explicitement comme tel, le bandit, est on ne plus reconnu, contrairement à l'anonyme, pourtant lui aussi hors la loi, mais pas reconnu. D'ailleurs, l'enfant dit illégitime, c'est à dire hors la loi, devait-il justement son infamant statut au fait de ne pas être reconnu, juridiquement s'entend, par le père, garant par son nom de l'ordre symbolique, de la loi. Mais peut-on parler d'anonymat concernant ces enfants du péché ? Je pense que oui, du moins tant que leur nom les plaçaient en dehors du cadre où la reconnaissance du sujet par ses pairs était possible, contrairement d'ailleurs au bandit, qui lui doit justement son existence audit cadre qu'il s'emploie à fracturer.
Heureusement, aujourd'hui, les « enfants naturels », comme s'il existait des enfants artificiels, ne sont plus stigmatisés. En fait, le terme « naturel » est à entendre comme émanant et restant au niveau de la nature, par opposition à ce qui spécifie l'humain : la culture, lieu de toutes les reconnaissances. Autrement dit, l'enfant naturel n'est que le fruit des pulsions bestiales de ses géniteurs (c'est la nature !), hors cadre, hors mariage, hors la loi, hors texte, hors langage, juste le produit d'un accouplement animal hors le désir du grand législateur... bref, un péché. Or, la culture, « la tradition dont on hérite » (Winnicott), c'est précisément ce cadre à l'intérieur duquel évolue tel ou tel groupe, et dont la structure est matérialisée par un ensemble de signifiants, de mots, que l'on nomme langage. Or, un mot ne se définit que par d'autres mots, eux mêmes définis par d'autres mots, etc... Démonstration, par Boby Lapointe (Leçon de guitare sommaire) : « une guitare est un instrument en forme de guitare... », où l'on voit qu'il est souhaitable qu'un signifiant renvoie à d'autres signifiants, et ce jusqu'à des signifiants majeurs permettant que se structure l'ensemble et que prenne corps cet ordre symbolique, la culture, la loi. Bien entendu, ladite structure, la loi, le langage, nous préexiste, nous étant délivrée de manière transcendante par le garant de la loi : le Père, et s'incarne par conséquent dans son nom. Evidemment, c'est de la fonction paternelle qu'il s'agit, le père symbolique, et la mère est aujourd'hui habilitée à l'endosser. On dira alors qu'il lui suffit de véhiculer le Nom du Père, entendu comme métaphore de la loi, permettant ainsi à l'individu nature d'être intégré à l'intérieur du cadre culture, et par là même reconnu.
Certes, nous voyons bien l'ambiguïté qu'il y a entre le nom du père réel et le Nom du Père métaphorique, et, contrairement aux apparences, ceci ne nous éloigne pas de notre sujet, l'anonymat, en ce que la personne qui se vit comme anonyme, alors qu'elle possède un nom, est donc en quelque sorte anonyme métaphoriquement, ce qui d'ailleurs ne retire rien à la réalité de son anonymat. Du coup, le chemin le plus court pour comprendre ce qu'est l'anonymat, notamment aujourd'hui, passe à mon sens par un rapide survol de la métaphore paternelle telle que conceptualisée par Lacan : « le Nom du Père ». Déjà, rappelons qu'une métaphore consiste à remplacer un mot par un autre mot de sens différent, mais dont le potentiel évocateur rapproche imaginairement de la chose à dire. Par conséquent, si la métaphore renvoie à une image permettant d'illustrer de manière plus précise notre pensée, elle occasionne cependant la perte du signifiant d'origine, le mot remplacé. Or, pour ce qui nous concerne, nous savons que le père est l'élément tiers qui, nommé par la mère, est désigné à l'enfant comme celui focalisant tout un pan du désir de la mère, désir évidement incompréhensible à l'enfant. Ainsi, le nom du père incarne-t-il cette triste réalité que notre bambin soit contraint de renoncer à sa toute puissance en tant que seul objet du désir de maman. Du coup, le Nom du Père prend le statut de métaphore comme signifiant du principe de réalité, de la loi, voulant que l'enfant renonce à son désir, dit incestuel, entrainant par là-même la perte du signifiant d'origine, dit « phallus », à savoir le désir de l'enfant d'être le seul objet du désir de sa mère. Rapporté à notre débat, cela signifie que pour être reconnu, ne pas être anonyme, il soit besoin d'inculquer à l'enfant la règle fondamentale constituant la base de notre culture, non pas l'interdit de l'inceste, comme on le pense bien souvent, alors qu'il s'agit d'une loi universelle, mais que l'autorité transcendante, incarnation de la loi, qui s'interpose entre le désir de la mère et celui de son enfant soit symboliquement représentée par la métaphore paternelle : le Nom du Père, là est la loi. Partant, l'enfant acquiert en quelque sorte son identité par transmission de ce signifiant majeur autour duquel se structure l'ordre symbolique de notre culture, perdant au passage la toute puissance de sa prime jeunesse. En somme, si l'enfant n'intègre pas le Nom du Père en tant que métaphore de la loi, il ne peut être reconnu par ses pairs, cela parce qu'il est en marge de la loi qui structure le groupe, restant donc, en quelque sorte, à la porte, « inconnu au bataillon ».
Serait-ce à dire, alors, que le sentiment croissant d'anonymat, notamment dans ces pôles d'évolution de la culture contemporaine que sont nos grandes cités, soit alors dû à une sorte de brouillard de pollution qui envelopperait d'un grand flou le Nom du Père de notre citadin, le laissant alors anonyme ? Si la réponse est oui, ce dont je ne doute pas, cela revient à dire que l'anonymat soit le fait d'une certaine déculturation, obligeant ainsi celui qui n'est plus tout à fait citoyen, sans Nom (sauf en ce grand moment d'hypocrisie générale que sont les élections), à se chercher quelque nouvelle structure où « son » Nom soit reconnu : une nouvelle horde, un nouvel ordre, voire, hélas, un ordre nouveau (ce à quoi nous assistons en permanence, où le délitement d'une culture complexe produit bien souvent des sous-cultures réduites au minimum, flattant l'individu en tant qu'éminent représentant de l'ordre, n'ayant d'ailleurs même plus besoin de nom, celui du troupeau en faisant office, ce que l'Histoire a nommer fascisme).
L'autre symptôme majeur de cette « évolution » culturelle, conséquence de l'anonymat, parlant alors sans ironie de néo-culture, c'est bien entendu l'art. Ainsi, le vingtième siècle a inventé l'art conceptuel, c'est-à-dire une redondance, puisque l'art est par nature conceptuel, que toute œuvre d'art est en soi un concept. Mais passons, après tout l'intention est excellente, voulant dire maladroitement que l'idée est plus importante artistiquement que la matière qu'elle engendre, quand bien même l'esprit fut le produit de la matière. Toutefois, comme l'a souligné Deleuze, un concept n'a de valeur que signé, non anonyme, c'est-à-dire qu'on puisse retrouver dans le paraphe de l'auteur le nom du père dudit concept, mais aussi le Nom du Père de notre auteur, c'est-à-dire l'ordre symbolique autour de laquelle s'est structurée la nécessité singulière qui présida au concept, le sens profond, l'entre les lignes... Mais d'accéder à l'art en question suppose aussi que son lecteur, l'interlocuteur de l'artiste, soit initié à ladite structure, qu'il partage le signifié (ce qui donne sens au signifiant) d'un même ordre symbolique, cela à fin de compréhension ; bref, que dans le nom de l'auteur et celui de l'interlocuteur soit contenu le même Nom d'un Père originel, chacun ayant renoncé à sa toute puissance infantile. Seulement, par un étrange mystère, si en matière de sciences dures ou molles, des mathématiques à la philosophie, il est reconnu que de produire du concept ne soit pas une mince affaire, l'art semblerait s'offrir à tous les désirs, et notamment celui de se faire un nom, à défaut de Nom, sortir de l'anonymat en somme. Bien sur, la plupart des grands créateurs ont eu ce désir, mais s'agissant alors, pour les plus ambitieux, de substituer leur nom à celui du Père, ce qui est dans l'ordre des choses, mais avant tout amoureux de l'art, du concept. Alors que pour nos artistes de pacotille, anonymes, en mal de reconnaissance, n'étant pas dotés du signifiant maitre (le Nom du Père), clef de voute de la structure permettant d'accéder à une subtile compréhension de l'art, ils ne peuvent voir de l'œuvre présentée que le reflet de leurs propres nécessités, encore prisonniers de leur toute puissance. Or, tant que l'art s'attacha d'abord à l'esthétique de la représentation métaphorique, l'image, plutôt qu'à la métaphore elle même, le concept, le lecteur put se contenter de sa propre perception du beau et, l'artiste en herbe, de la technique permettant d'y accéder. Mais l'art conceptuel, en supprimant pour beaucoup la contrainte esthétique et technique, laisse en quelque sorte le lecteur, anonyme, face à la toute puissance de son désir, comme devant un livre rempli de pages blanches (voire l'introduction au débat : La page blanche -Lien- ). Songeons par exemple à ce que peut ressentir la personne souffrant d'anonymat face une toile bleu de Klein (une page bleue), comme s'il suffisait d'un quelconque barbouillage pour se faire un nom... et de l'argent.
D'ailleurs, en parlant d'argent, cela nous renvoit à ce que soutient le Nom du Père, la loi, à savoir « le discours du maitre », indiscutable, que l'on nomme aussi « valeurs ». Or, à bien y regarder, à écouter surtout, le seul discours qui soutienne la structure de notre (néo) culture, notamment en ville, le discours du maitre, transcendant, c'est le discours capitaliste, indiscutable, qui va de soi, dont la seule valeur est l'argent, le profit sonnant et trébuchant. Du coup, si notre pseudo artiste anonyme souhaite se faire un nom, il faut aussi que celui-ci soit monnayable, ce qui vaut aussi pour le vulgus pécum, sombrant dans l'anonymat lorsqu'il sort du système productif, là où son un nom est reconnu. Nous sommes donc passés de l'art à l'art conceptuel, et de l'art conceptuel au produit, le concept étant dorénavant dans les mains du marchand, notre nom aussi.
En termes psychanalytiques, cela veut dire que nous sommes passés des traditionnelles structures névrotiques, œdipiennes, avec angoisse de castration, culpabilité et tout le toutim, avec pour symptôme de la bonne grosse névrose, hystérique ou obsessionnelle, et que nous avons tranquillement glissé, à mesure que s'installait le néo-discours du maitre, capitaliste, vers ce qu'on nomme aujourd'hui « les états limites », où le sujet peine à sortir de la dépendance maternelle, le Nom du Père étant difficilement associable à de l'humain, puisqu'il est marchandise, laissant un sujet à la fois tout puissant et en proie à des angoisses d'abandon, de perte d'objet, avec pour symptôme la dépression (voire l'introduction au débat : Etats limites -Lien-). Nous retrouvons donc ici l'ambiguïté entre le père réel et le Père symbolique, métaphorique, où, malgré tout, le Nom du Père pouvait s'incarner dans une ou plusieurs figures réelles, transcendante, ce qui à présent est nettement plus difficile. D'ailleurs, malgré nombre d'idéologues du capital, aucun n'en n'incarne la valeur, celle-ci n'étant pas humaine. Au moins, Dieu était-il soutenu par un désir de création, à notre image évidemment. Du coup, sans filiation, mis à part le désir de maman, nous voilà anonymes et dépressifs. Finalement, il n'y a pas grand chose de neuf sous le soleil, et que pour se faire un nom il nous faille comme de tout temps tuer le Père, à condition, bien sur, de l'identifier.
GG (désolé, je reste anonyme, hors la loi, romantisme oblige !)
Lorsqu'en psychanalyse on parle de créativité, un nom vient tout de suite à l'esprit,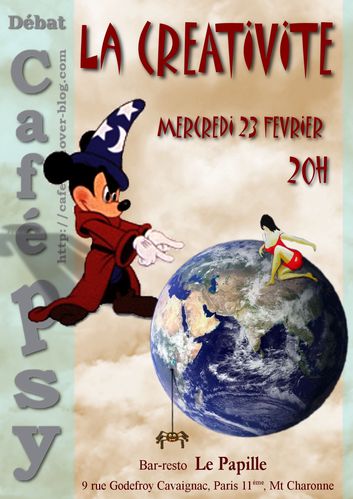 c'est celui de Winnicott. Selon lui, un individu sain est celui qui n'aura pas été empêché de développer et d’entretenir son potentiel à vivre créativement, potentiel dont nous sommes tous dotés et qui se déploie pour chacun au quotidien, si tout va bien. Nous voyons donc, d'emblée, qu'il convient de distinguer une créativité fonctionnelle, de tous les jours, d'une créativité « forcée », active, généralement associée à des pratiques plus ou moins artistiques : créatives, comme l'on dit. Winnicott définit ainsi la créativité : « conserver tout au long de la vie une chose qui fait partie de l'expérience de la première enfance : la capacité de créer le monde » (in Conversations ordinaires). Quant à la manière dont nous en usons : « par vie créatrice, j'entends le fait de ne pas être tué ou annihilé continuellement par soumission ou par réaction au monde qui empiète sur nous ; j'entends le fait de porter sur les choses un regard toujours neuf » (ibid).
c'est celui de Winnicott. Selon lui, un individu sain est celui qui n'aura pas été empêché de développer et d’entretenir son potentiel à vivre créativement, potentiel dont nous sommes tous dotés et qui se déploie pour chacun au quotidien, si tout va bien. Nous voyons donc, d'emblée, qu'il convient de distinguer une créativité fonctionnelle, de tous les jours, d'une créativité « forcée », active, généralement associée à des pratiques plus ou moins artistiques : créatives, comme l'on dit. Winnicott définit ainsi la créativité : « conserver tout au long de la vie une chose qui fait partie de l'expérience de la première enfance : la capacité de créer le monde » (in Conversations ordinaires). Quant à la manière dont nous en usons : « par vie créatrice, j'entends le fait de ne pas être tué ou annihilé continuellement par soumission ou par réaction au monde qui empiète sur nous ; j'entends le fait de porter sur les choses un regard toujours neuf » (ibid).
Alors, évidemment, n'étant pas Dieu, ou si peu, on peut se demander ce qu'il en est de notre capacité à créer le monde, et si cette formule ne serait pas légèrement exagérée. Par ailleurs, il pourrait sembler paradoxal que nous puissions être annihilés et tués par le monde que nous aurions eu nécessité à créer, quoi que, selon Nietzsche, il serait en notre pouvoir de tuer Dieu, et même l'aurions nous fait, un genre d'auto-destruction en somme. Sauf qu'à en croire Winnicott, c'est justement de ne pas créer le monde, de laisser empiéter sur nous ce qui est déjà là, créé par d'autres, qu'alors nous finirions par succomber, étouffés par le réel, soumis à l'ordre des choses, vaincus par abandon. En fait, une partie du génie de Winnicott est d'avoir mis en évidence ce paradoxe au cœur du fonctionnement humain : que nous sommes en mesure, non pas de recréer ce qui est déjà là, mais de le créer. Malheureusement, Winnicott nous ramène sur terre en parlant d'illusion, et aussi de désillusion, condition pour accéder au « principe de réalité ». Ainsi, lorsque le nourrisson fraîchement débarqué au monde a besoin du sein maternel pour combler sa faim, il lui faudra peu à peu intégrer que, dorénavant, il sera nourri par un objet extérieur, le sein, ou le biberon, à la différence de lorsqu'il se trouvait dans l'utérus, où il lui suffisait en quelque sorte d'ouvrir la bouche. Mais d'intégrer cela, donc, demande un certain temps, de sorte qu'au début le bébé demeure dans cette dynamique d'omnipotence où il subvenait lui même à ses propres besoins, lorsque lui et son environnement formaient un tout, et qu'à présent le sein soit sa création en tant qu’illusion nécessaire au maintien du tout en question. Quant à la mère, ou de qui en détient la fonction, son rôle est d'entretenir suffisamment longtemps ladite illusion en plaçant son sein à l'endroit et au moment où son enfant pourra le créer. Son bambin s'apercevra bien assez tôt que l’objet sein appartient à cette satanée réalité extérieure sur laquelle nous n'avons qu'une prise aléatoire. Alors, la réalité rattrapera inexorablement l'enfant, jusqu'à tenter de la manipuler, de la mettre en scène, de s'y adapter, de l'apprivoiser et, finalement, de la créer : c'est le domaine du jeu, où cette fois, par contre, on transforme l'illusion en réalité.
Jouer, créer, pour l’enfant, c’est d’abord établir un espace intermédiaire entre soi et l’extérieur, une aire dans laquelle l’objet n’est plus appréhendé comme partie de soi, mais soumis malgré tout aux besoins de l’enfant, comme la totalité de son monde, un espace où l’objet extérieur à l’enfant est néanmoins créé par lui en tant que support de ses projections, de son désir, donc pas vraiment dedans, mais pas complètement dehors, entre deux. C’est ainsi la possibilité de créer et manipuler un symbole sur lequel l’enfant peut continuer d’exercer un contrôle omnipotent, entre lui et le dehors, en quelque sorte un objet médian, permettant à notre bambin d’opérer une transition entre la perception de son seul monde immédiat et un réel externe nettement séparé de lui. Chez le bébé, le premier « objet transitionnel », son premier doudou, est généralement un bout de tissu imprégné de l’odeur de la mère, foulard ou autre, qui symbolisera pour l’enfant la rassurante présence maternelle en l’absence de cette dernière. Notons que la mère adaptant son désir au besoin de l’enfant en lui permettant de créer ce qui est déjà là, elle participe ainsi à la construction de cette aire intermédiaire, et, bien que l’on puisse difficilement parler d’échange avec sa progéniture, sauf si elle-même ne se laisse bercer par cette illusion (qui après tout n’est pas réservée aux seuls enfants), il en résulte néanmoins la création d’un espace commun, entre deux, alimenté par les désirs de chacun. Plus tard, lorsque l’enfant accèdera au symbolique par le langage, ses jeux s’affineront en des mises en scène visant à éprouver le monde, la manière de s’y déplacer et le bon usage des émois consécutifs, et toujours dans cette aire intermédiaire que Winnicott a nommé « espace potentiel », espace où l’enfant développera sa créativité et où s’initiera l’expérience culturelle : « La place où se situe l’expérience culturelle est l’espace potentiel entre l’individu et son environnement. (…) L’expérience culturelle commence avec un mode de vie créatif qui se manifeste d’abord dans le jeu. » (in Jeu et réalité). Par exemple, lorsque nous voyons une petite fille jouer à la poupée, ce n’est pas un objet inerte qu’elle manipule, mais le sujet qu’elle aura créé, souvent à son image, évoluant dans le paradoxe d’une reproduction fictionnelle, s’entraînant ainsi à la maîtrise d’une réalité devenue sienne, et non plus simplement la réalité des autres. L’espace dans lequel se déroule le jeu est donc à la fois d’éprouver un modèle culturel existant, mais qu’elle aura néanmoins créé, entre deux donc, et d’éprouver en elle, sur un objet externe (la poupée), toujours entre deux, une manière singulière et créative d’être au monde.
Nous voila donc, maintenant, entrés dans le symbolique, le langage, qui constituera dorénavant notre réalité, ce que nous appelons la conscience. Or, parler et écouter, interpréter, s’inscrit en continuité des efforts créatifs de notre prime jeunesse. En effet, parler consiste en une tentative de partager un point de vue singulier, le notre, à l’adresse d’un tiers se situant nécessairement d’un autre point de vue. Par exemple, si vous et moi évoquons le stylo qui se trouve là, sur la table, entre nous, il ne fait aucun doute que nous parlons bien du même objet réel, alors que nous ne voyons pas la même chose puisque placés sous des angles différents. Cependant, d’utiliser le même symbole, le mot stylo, nous permet malgré tout de communiquer autour d’une perception différente. Mais si comme à présent je vous parle du stylo posé à coté de moi, cela par l’intermédiaire de nos écrans d’ordinateurs, c’est en faisant appel à ce que signifie pour vous le mot stylo que vous pourrez créer, vous représenter, l’objet dont je vous parle, un tube plus ou moins esthétique à l’intérieur duquel se trouve une cartouche d’encre terminée par un système à bille permettant de déposer, de manière régulière et continue, l’encre susmentionné sur du papier, et cela, à priori, dans le but de tracer du symbole. Mais un mot, un symbole, un signifiant, s’il est isolé, ne signifie justement pas grand-chose ; c’est par l’association à d’autres mots, d’autres signifiants, que l’objet prendra du sens, ce que nous essayons de partager avec nos congénères, le signifié, communiquer en somme, créer les ponts qui nous permettrons de rejoindre à la croisée des désirs, objet de nos incessantes recherches (voire l’introduction au débat : Le désir -Lien-). Or, si j’ai pris comme exemple de signifiant le mot stylo, plutôt que cheval, carafe, faire, ou angoisse, c’est qu’en cherchant autour de moi un objet particulièrement signifiant, pour moi s’entend, c’est en voyant sur mon bureau le joli stylo rouge que je me suis offert il y a deux ans que le mot s’est imposé. Autrement dit, pour moi, un stylo n’est pas qu’un tube, et pour personne d’ailleurs, qu’il nous rappelle l’outil par lequel, à force de lignes répétées, nous étions contraints en d’interminables punitions, signifiant des heures à jamais sombres d’une scolarité poussive, ou bien, épistolier amoureux, vivant nos fantasmes dans l’entre les lignes de chaînes signifiantes enfiévrées, ou encore, écrivain en herbe… etc., le stylo pourrait être entendu comme un symbole de la créativité, qu’il l’inhibe ou l’exacerbe. Je crois d’ailleurs que toute analyse pourrait commencer par notre rapport à un stylo, donc à l’écrit, au langage, ou peut-être la finir. Quoi qu’il en soi, c’est en associant le symbole stylo à d’autres signifiants, en formant des phrases, comme je viens de le faire, que nous commencerons à parler d’un même objet, c'est-à-dire des émois qui présidèrent au sens actuel du mot, le signifié. Et si le dialogue parvient à s’instaurer, que nous accédions l’un et l’autre audit signifié, dans l’entre les lignes des discours, nous atteindrons peut-être à cet espace potentiel décrit par Winnicott, entre deux, espace de la créativité (voire l’introduction au débat : Une aire de confluence -Lien-). Mais là, somme toute, en parlant de stylo, la chose est encore relativement aisée ; imaginons que nous parlions d’amour… à moins que notre stylo en soit le prétexte, ou, qu’après tout, quel que soit l’objet nous ne parlions que de ça, à grand renfort de créativité et autre stylo, entre deux…
C’est donc en accédant au registre symbolique (au langage) que nous construisons la réalité, créativement, dans l’après coup de l’interprétation. Nous savons maintenant que de nommer les choses, qu’il s’agisse d’un objet, d’une action ou d’un sentiment, nous renvoie d’abord à la charge émotionnelle dont nous enveloppons le mot et la phrase ; je peux décrire mon stylo en long, en large et en travers, il en manquera toujours un bout, un peu comme si je le dessinais sous tous ses angles, en plein et en coupe, je ne parviendrais jamais à appréhender d’un coup la totalité de l’objet, le réel, sans une interprétation forcément subjective du descriptif. Mais pire, si je vous parle de mon stylo, c’est qu’un désir a motivé mon propos, sans quoi je n’aurais rien dis. Or, l’origine de ce désir ne peut que nous être inconnu, puisque en remontant à sa source nous atteindrons tôt ou tard mon inconscient qui, comme son nom l’indique, nous est inaccessible. En fait, mon stylo n’est qu’un condensé de mystères qu’il nous faudra chacun résoudre à notre manière, c'est-à-dire, comme l’enfant, s’emparer de l’objet existant, réel, et de le créer en quelque sorte à notre image, mais de manière adaptée au contexte, être créatif en somme. User d’un langage, quel qu’il soit, commun ou artistique, consiste donc toujours en une tentative de cerner le réel, tentative qui se traduira en terme de réalité, de subjectivité, et qui produira un reste, réel, « ce que le symbolique expulse en s’instaurant » (A Vanier). Tous nos efforts créatifs, plus ou moins illusoires, viseront donc à retrouver ce réel égaré dans l’entre les lignes de nos tentatives à le formuler. Au passage, notons que notre conscience ne sait rien du présent, du réel, puisque étant le produit de notre subjectivité, d’une interprétation, donc dans l’après coup. Evidemment, parler d’un stylo ne nous demandera probablement pas d’efforts démesurés coté créativité, guère plus que lorsque je demande du pain à ma boulangère. Par contre, si d’aller chercher ma baguette est l’occasion d’entretenir les braises que ladite boulangère attise en moi, nous comprendrons que les mêmes mots ne recouvrent plus du tout la même réalité, et que le « s’il vous plait » à la fin de ma demande, excédant largement celle d’une simple baguette, soit l’occasion d’un grandissime voyage imaginaire chaque fois renouvelé, à moins qu’il ne s’agisse de l’entretien d’une intense frustration, à nous d’être créatifs selon la réalité qu’on souhaite construire. Ici, la difficulté sera de suggérer à ma boulangère l’indicible passion, réelle, contenue dans l’entre les lignes de ma demande, de faire en sorte que ma créativité titille la sienne, et réciproquement, cela pour que s’instaure cet espace potentiel, entre deux, où pourra s’exprimer le réel de nos émois.
Ce dernier exemple, celui de ma boulangère, nous montre comment vivre créativement est important pour justement se sentir vivant, ou comment réinventer le monde au travers de symboles que l’on fait nôtres, et qui pourtant nous préexistent. C’est d’être en mesure de porter sur les choses un regard toujours neuf, créatif. En effet, pour la plupart d’entre-nous, aller chercher une baguette ne conduit pas nécessairement au pinacle, et nous ressortons de la boulangerie sans nous sentir plus vivants qu’en y entrant, voire un peu plus accablés par la routine, sauf à emporter avec nous quelque miche de la boulangère… comme quoi, une baguette, signifiant éculé, peut-il ouvrir à une merveilleuse réalité. Dès que nous sortons du réel pour entrer dans l’après coup de l’interprétation, du symbolique, de la conscience, c’est en nous emparant d’un système symbolique qui nous préexiste : ce n’est pas nous qui avons inventés la syntaxe, ni les mots que nous utilisons pour élaborer notre pensée, notre désir. Autrement dit, ce qui est dorénavant notre réalité s’enracine dans celle de l’Autre, dans un ordre symbolique auquel nous n’avons d’autre choix que de nous plier, ce que l’on nomme « principe de réalité ». Pourtant, chacun de nous est un être réel, unique, fruit du contingent, et que nul symbole, nul langage, ne peut circonscrire. Il nous faut donc trouver l’équilibre entre une nécessaire soumission au principe de réalité, au désir de l’Autre, sans pour autant renoncer au sentiment d’un soi réel. Pour ce faire, entre la constitution d’un « faux soi » et le repli sur un monde intérieur à jamais perdu, qui dans un cas comme dans l’autre nous laissera le sentiment que tout est vain, que la vie n’en vaut pas la peine, le seul moyen est de porter sur les choses, sur le monde, un regard neuf, à savoir, d’utiliser les symboles à notre disposition afin de mettre en relief l’entre les lignes de nos discours, le signifié, l’indicible de nos émois (voire l’introduction au débat : La page blanche -Lien-), c'est-à-dire de nous surprendre nous même en creusant les apparences, bref, être créatif, ou encore, de se laisser aller à l’intelligence, au sens étymologique du terme : inter ligere, lire entre les lignes.
Pour finir, il semble difficile de ne pas dire un mot concernant le versant ostentatoire, dit artistique, de la créativité. Nous avions vu, dans un précédent débat (La sublimation -Lien-), que les mécanismes à l’œuvre dans cette zone de la créativité, et plus globalement dans toute production conceptuelle, relevaient sans doute assez peu de la «sublimation » telle que proposée par la psychanalyse, sublimation inventée par Freud en tant que détournement d’une pulsion sexuelle ou agressive, mais dont il concéda lui-même que ladite sublimation devait beaucoup à du jugement de valeur. En fait, je pense que la psychanalyse n’échappe pas aux fantasmes romantiques autour de l’image de l’artiste, seul habilité à côtoyer le sublime. D’ailleurs, la pratique de la psychanalyse est souvent associée, à juste titre, à un art. Comme l’artiste, le but du psychanalyste est de favoriser l’émergence d’un espace potentiel, intermédiaire, entre son interlocuteur et lui. Mais là où l’artiste crée sur la tradition culturelle son propre agencement symbolique, son œuvre, pour essayer de mettre au jour, à nu, le réel en lui afin d’y laisser pénétrer le réel de quelque interlocuteur idéal, et peut-être lui-même, le psychanalyste, lui, s’efforcera d’être d’emblée cet interlocuteur idéal par lequel l’entre les lignes, réel, de la production symbolique de l’analysant trouvera à s’exprimer, jusqu’à transférer le réel en souffrance dans cet espace potentiel entre l’analysant et l’analyste, là où il est possible d’en jouer, de le décoincer en somme. L’artiste de talent, ce qui vaut aussi pour le psychanalyste, se reconnaît donc à sa capacité d’interroger le réel en lui et en nous, et non pas, comme nous le voyons souvent, de par une production venue tout droit de sa période anale, genre, « regarde maman comme je t’ai fait un beau caca ! », attendant simplement l’assentiment maternel. Malheureusement, la psychanalyse, contrairement à la cuisine, aux yeux du grand public, n’est pas reconnue en tant qu’art, d’où les fantasmes susmentionnés autour de l’artistique et du sublime, une sorte de besoin de reconnaissance. L’artiste, donc, dont nous admirons la créativité, est en fait celui qui pour se sentir vivre, exister, se surprendre, ne pas succomber au principe de réalité, ne pas être étouffé par le désir de l’Autre et trouver les ressources nécessaires pour créer sa réalité au détour d’un chemin, dans une boulangerie, ou en regardant un stylo, est celui qui doit sans cesse bousculer, interroger, jouer avec la réalité de l’Autre, l'ordre symbolique, afin d'y trouver quelque assise pour construire sa réalité, et peut-être enfin sa propre voie, créative. Somme toute, l’art est une excellente thérapie pour qui n’est pas assez créatif, au quotidien s’entend. Et n’oublions pas cette assertion de Picasso : « L’art c’est quatre vingt quinze pour cent de transpiration pour cinq pour cent d’inspiration », ce qui, bien entendu, vaut aussi pour la psychanalyse.
GG
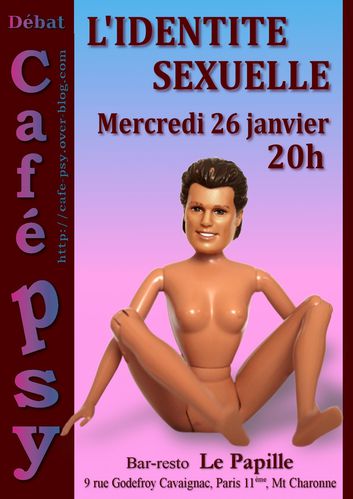
Contrairement au sexe proprement dit, généralement défini par un groupe de chromosomes, ou l'apparence de nos organes génitaux, l'identité sexuelle est le produit de notre identification à ce que la norme sociale définit comme genre féminin ou masculin. Il y a donc trois manières de nous représenter en tant qu'êtres sexuellement différenciés : biologiquement, en se référant aux chromosomes, XX pour le féminin et XY pour le masculin (bien qu'il existe d'autres génotypes) ; puis socialement, le genre, en référence aux stéréotypes du féminin et du masculin tels que définis par la norme sociale, à savoir une apparence et des comportements adéquats au genre ; et un registre personnel, intime, l'identité sexuelle, qui est la manière dont chacun se perçoit au regard de la norme, c'est le sentiment de soi comme appartenant à un genre. Là où commencent les soucis, c'est lorsque ces trois façons se révèlent incompatibles entre elles, du moins selon la norme. Et encore, même si tout est sa place, il suffit d'une orientation sexuelle, d'un désir, qui ne soit pas exclusivement hétéro pour que l'édifice puisse vaciller.
Les problèmes surgissent donc lorsque le sentiment de soi, de son identité sexuelle, se heurte à la norme, sociale ou génétique. Rappelons qu'il est deux types de normes qui ne coïncident pas nécessairement : celles misent en évidence par Canguilhem, que l'on pourrait dire naturelles, comme quoi la vie implique des normes régies par un ordre universel ; puis, des normes culturelles, créées par nous, autant pour assoir le pouvoir de leur prescripteur, ou de qui s'en fait le garant, que de formaliser le lien social, c'est l'ordre symbolique, passant par le langage. Comme exemple de norme naturelle, bio, nous constaterons ainsi que quelle que soit la température ambiante, le corps humain doit se maintenir aux alentours de trente-sept degrés, c'est la norme associée à l'espèce (in Les jeux du normal et du pathologique - D. Bourdin). Toutefois, l'écart à la norme s'intègre aussi à la norme : ainsi, un canard à trois pattes n'en est pas moins canard. Par contre, afin d'illustrer le rapport entre pouvoir et ordre symbolique autour du sujet qui nous intéresse, l'identité sexuelle, nous remarquerons que dans une société donnée, plus les instances de pouvoir sont autoritaires, rigides, moins l'écart à la norme est toléré. Ainsi, lorsque l'identité sexuelle d'un individu ne coïncide pas précisément avec le genre féminin ou masculin tel que prescrit par la norme, ledit sujet est alors considéré déviant, puni et mis à l'écart, voire tout simplement éliminé. La question est alors de savoir en quoi une identité sexuelle « inadéquate » au genre, vu comment notre canard boiteux est alors traité, représente une menace pour l'ordre établi ?
Avant de tenter une réponse à cette question, voyons de quels stéréotypes sont porteurs le féminin et le masculin pour que le non-respect de ceux-ci soit susceptible de bouleverser la cohésion sociale. Déjà, la psychanalyse, dès Freud, en associant pulsion de vie et libido, désir et sexualité, culpabilité et angoisse de castration, affirmation de soi et phallus, etc., estimera que les différences anatomiques entre femmes et hommes modèlent le psychisme du sujet par une approche différente de la période œdipienne. Ainsi, d'être doté d'un vagin ou d'un pénis aurait des conséquences pour ainsi dire universelles en terme de stéréotypes psychiques et comportementaux, les contingences auxquelles chacun est confronté se chargeant du rapport entre lesdits stéréotypes et la singularité du sujet. Certes, bien que pas très convaincant, Freud précisera néanmoins que nombre de ces références à la sexualité sont aussi à comprendre en tant que métaphores, mais n'altérant en rien le stéréotype puisque se développant dans le registre symbolique. Partant, la psychanalyse se retrouve prise dans le paradoxe où elle même affirme et promeut la différence des sexes au travers de paradigmes métapsychologiques confirmant les lieux communs associés au genre, et, à coté de ça, dans l'affirmation du singulier comme irréductible aux généralités. Par exemple, un des concepts fondamentaux de la psychanalyse est le « phallus », organe symbolique incarné par une chose signifiante (peu importe quoi) que femmes et hommes mettront en avant pour affirmer leur désir et signifier leur place dans un ordre symbolique où l'on se doit d'assoir quelconque pouvoir. Ainsi, le phallus, référence masculine s'il en est, « signifiant du désir » nous dit Lacan, incarne t-il la puissance souveraine au sein de cet ordre symbolique véhiculé par le « nom du père ». Puis, coté féminin, nous trouvons le masochisme (voire l'introduction au débat : Le masochisme -lien-), mettant en avant cette qualité toute féminine d'accueillir la souffrance dans une position de soumission, quoi que là aussi appartenant aux deux sexes. En tous les cas, même si femmes et hommes sont concernés par ces deux opposés, le moins qu'on puisse dire est que la psychanalyse n'a pas eu peur des stéréotypes comme opérants dans la réalité du sujet. Bien entendu, il n'est pas question de faire le compte de tous les clichés associés au genre, mais ces derniers me semblent assez signifiants pour résumer l'état de notre imaginaire, pour ne pas dire bestiaire.
Au passage, nous voyons que ces trois manières de définir notre sexe, biologiquement, socialement, intimement, peuvent être associées aux trois registres mis en évidence par Lacan et dans lesquels évolue la condition humaine : l'imaginaire, le symbolique, le réel. Ainsi, la façon biologique, avec le génome, c'est-à-dire propre à l'espèce, peut être considérée comme une tentative d'approche du réel. Pour ce qui est de la façon sociale, ce que la norme définit comme genre féminin ou masculin, nous sommes en plein dans le symbolique, à savoir l'énoncé commun, sous forme de lois explicites ou implicites, de ce que doit être une femme ou un homme. Quant à la façon intime, l'identité sexuelle, le sentiment de soi, nous sommes dans l'imaginaire, à savoir le rapport que nous entretenons à notre image et à celle de l'autre. Rappelons que Spinoza, déjà, nous disait que « l'esprit est l'idée du corps », autrement dit, toute production de l'esprit, à commencer par le sentiment de soi, est le produit d'expériences réellement vécues, c'est-à-dire passant au travers d'une perception corporelle, et donc par l'idée en image que nous avons de nous même, ressentie dans notre chair à un moment donné. Nous pourrions rattacher cela à ce précédent débat où il était question de l'efficience de nos plus anciens souvenirs (L'impact des souvenir d'enfance, -lien-), où nous avions vu que Proust s'était souvenu du contexte émotionnel à l'origine de son bonheur actuel à éprouver le goût de sa fameuse madeleine lorsqu'il put replacer son image dans ledit contexte, se voyant alors , se ressentant, enfant heureux chez sa tante Léonie. Pareillement, notre identité sexuelle est le produit émotionnel de notre ressenti à l'énoncé de ce qu'est la bonne image du féminin et du masculin, ressenti projeté sur notre image. Partant, notre identité sexuelle est cette conviction, fruit de notre imaginaire, incrustée au plus profond, dans notre chair et dans notre esprit, que l'on peut donc concevoir comme le corps de notre âme, ou l'inverse, l'âme de notre corps.
Peu importe donc de savoir si notre identité sexuelle est ou non fondée ; qui mieux que nous peut le savoir, puisqu'elle est notre âme, notre imaginaire, reliée d'un coté au réel, de l'autre au symbolique, produit culturel et organique à la fois, « l'esprit » en tant qu'« idée du corps ». Mais pour ce qui est du lien entre identité sexuelle et réel, outre que de définir les individus comme féminin ou masculin relève du symbolique, si l'on se réfère par exemple aux chromosomes, ce n'est pas forcément très net. Il existe en effet cent quatre vingt seize combinaisons possibles, XX et XY étant les plus fréquentes, mais que faire des autres, notamment celles qui prêtent à confusion au vu des organes génitaux ? Pareillement, si l'on considère uniquement l'anatomie apparente, ou classera-t-on celui ou celle doté d'organes ne correspondant pas aux standards en vigueur, ou tout simplement avec son désir ? C'est donc évidemment le lien entre identité sexuelle (imaginaire) et symbolique (la norme) qui fait problème, le réel échappant par nature à toute définition, il est, c'est tout, là est le lien entre identité sexuelle et réel, indicible. Or, une société, une culture, n'a d'existence que dans le symbolique, se définissant par ses normes, à commencer par sa langue, son histoire, ses mythes, son organisation, patriarcale ou matriarcale, ses lois, ses codes, ses rites, sa hiérarchie, etc... tout ça permettant que s'établisse la cohésion sociale, l'adhésion de chacun à cet ordre symbolique en étant le garant. Du coup, selon la plus ou moins grande tolérance de la société en question, celui qui déroge à la norme risque d'être perçu comme une menace à l'encontre de ladite cohésion. En fait, plus l'instance de pouvoir souhaite diriger le corps social comme un seul homme, plus celui qui s'en écarte potentialise le risque que d'autres se sentent autorisés à s'éloigner à leur tour, quel qu'en soit le motif. Partant, tout écart à la norme, au normal, doit être sanctionné. Nous sommes donc là face à un sentiment de peur généré par la différence ; c'est en quelque sorte la peur de l'étranger, du produit d'une autre culture, d'autres normes pouvant contaminer les nôtres.
Parler d'identité sexuelle, c'est avant tout approcher l'une des dernières frontières avant les insondables profondeurs du désir, un peu comme parler d'amour, où l'on s'aperçoit que l'âme est irréductible au collectif, autorisant le sujet à ses propres errances symboliques. Sauf que pour ce qui est de l'amour, l'institution peut difficilement nous en affranchir totalement, celui-ci étant aussi une stratégie de l'espèce pour assurer sa pérennité (voire l'introduction au débat : Pourquoi l'amour ? -lien-). Mais même là nous voyons à quel point l'autorité, qu'elle soit religieuse, politique, ou économique, tente d'encadrer nos émois afin que le sujet en proie à sa passion s'éloigne le moins longtemps possible de son cheptel d'origine, et tout ça pour aller conter fleurette. Plus le pouvoir se veut fort, inébranlable, plus le désir du sujet (de l'objet devrait-on dire), ce qui le singularise, doit être éradiqué, ne conservant pour horizon que le maintien d'un ordre symbolique intouchable, impensable, sacré. Celui qui n'adhère pas doit être éliminé, au risque de la contagion. En somme, le principal péril auquel est confronté le pouvoir, c'est la singularité du désir. Alors, forcément, quand un homme vient nous dire qu'il fut mal étiquetté, que la société s'est trompée, qu'il est en fait une femme, ou l'inverse, ça fait désordre, le gueux vulgus pourrait soudain croire que tel n'est pas sa place, qu'il put être calife à la place du calife, que cela comblerait bien mieux son désir, c'est alors l'anarchie, le chaos... Nous pouvons donc dire que les mouvements de répression à l'encontre de ces étranges individus, dits pédés, travelos, trans., etc., qui ne parviennent pas à maitriser un désir incompatible avec leur genre d'attribution, voire même qui le revendiquent, désir alors énoncé par l'autorité comme aberrant et par là même dangereux, que cette répression, donc, est la conséquence d'une peur inélaborable face au danger potentiel que représente tout écart à la norme. De plus, l'histoire est assez riche en ce sens, nous voyons que ces condamnations de la différence sont le fait de « pensées » autoritaires, totalitaires, réactionnaires, intégristes, fascisantes, tout simplement obtuses, partout où le mot tolérance est réservé aux dites maisons, dans lesquelles on caricature jusqu'à l'outrance nos bons vieux stéréotypes, moyennant finance comme il se doit.
En somme, nous aurions d'un coté le camp d'une tolérance bien pensante, à gauche évidemment, revendiquant le droit à la différence entre frères humains, puis, à droite, le camp des méchants, où les dites différences sont inconcevables et dangereuses, notamment comme exemple en direction d'une jeunesse en mal de repères. Mais là, nous ne faisons qu'évoquer les réactions face à ceux dont l'identité sexuelle est en quelque sorte hors norme, où les différences d'avec les standards religieusement établis peuvent être perçus comme le signe avant-coureur de l'état de dégénérescence d'une société perpétuellement menacée de décadence, donc de destruction. Sauf que, l'identité sexuelle ne pose pas problème que dans le hors-piste, et que sur les voies bien balisées du féminin et du masculin l'on tente aussi de supprimer les écarts, supposant que si disparité il y a, celle-ci ne pourra être interprétée que qualitativement. Or, vu que nous évoluons dans une société patriarcale, la distinction homme-femme se fera naturellement au bénéfice des premiers, entendu que différence et égalité soient antinomiques. Du coup, voilà que les rôles sont inversés, ceux-là même qui prônaient le respect de la différence à propos du hors-norme, veulent à présent supprimer les particularismes associés aux genres, entendu, donc, que si femmes et hommes sont identiques, qu'il n'y a pas de différence, ils sont forcément égaux. Ainsi, devient-il tout naturel d'intégrer celui ou celle dont l'identité sexuelle est selon la norme inadéquate au genre, puisqu'il n'y a plus de différence, mais déniant par là-même le sentiment du sujet qui souhaite justement affirmer sa singularité, quelle que soit la piste empruntée, balisée ou non.
Certes, nous pourrions en appeler à la science pour trancher le débat, savoir si l'identité sexuelle est culturelle ou biologique, ou les deux, et dans quelle proportion ? A en croire Doreen Kimura, professeure de psychologie à la Simon Fraser University, de nombreuses expériences tendent à démontrer qu'il y aurait bien des différences cognitives significatives entre les sexes. Par exemple, allant dans le sens des stéréotypes, « la plupart des tests d'aptitude spatiale montrent certains avantages en faveur de l'homme, qui excelle en particulier dans la rotation mentale et dans le lancer de précision. La femme, cependant, réussit en général mieux à se souvenir des positions d'objets dessinés sur le papier et de repères sur un chemin. Il s'avère que l'homme trouve son chemin essentiellement en se fondant sur les propriétés géométriques de l'espace, alors que la femme a tendance à utiliser plus souvent des objets spécifiques » (in Cerveau d'homme et cerveau de femme ?). Par ailleurs, lors de la croissance intra-utérine, il semble aujourd'hui acquis que les hormones n'influent pas seulement sur le développement du corps, mais aussi sur celui du cerveau. Nous serions donc dotés dès la naissance d'un cerveau sexué, fille ou garçon. Toutefois, selon le chercheur Olivier Klein, synthétisant, lors d'une conférence dispensée à l'Institut des Hautes Etudes de Belgique, les résultats de nombreux travaux visant à étudier l'éventuel bien fondé des stéréotypes psychologiques associés à la différence des sexes, celui-ci nous dit qu'effectivement « ces différences tendent à se conformer aux stéréotypes de genre », mais que d'en appeler aux neurosciences pour établir un lien entre ces différences psychologiques et celles structurelles du cerveau de l'homme ou de la femme était pour l'heure encore illusoire, d'autant que « il est souvent ardu de déterminer si ces différences sont innées ou sont au contraire produite par l'environnement : après tout, on ne peut pas exclure que les activités différentes des hommes et des femmes tendent à affecter la structure de leur cerveau, dont la plasticité n'est plus à démontrer ». Par contre, toujours rapporté par Olivier Klein, ce que mettent en évidence nombre d'études, c'est la valeur prédictive des stéréotypes, comme quoi le sujet aurait tendance à s'y conformer afin de faciliter les « relations aux membres de l'autre sexe » (1). Ainsi, l'assertion de Simone de Beauvoir, « on ne nait pas femme, on le devient », serait en partie fondée, quoi que ladite partie soit encore impossible à circonscrire scientifiquement, ce qui laisse de beaux jours à l'expression de notre subjectivité dans les débats sur l'identité sexuelle et les différences attenantes, et c'est tant mieux.
Pour finir, mentionnons la psychologie évolutionniste, pour qui l'évolution a sélectionné des comportements différents selon les genres, où l'identité sexuelle s'affirmerait notamment dans les rapports de sélection homme-femme, chacun étant contraint à des stratégies différentes pour perpétuer sa lignée, son propre génome (voire l'introduction au débat : La créativité, dispositif de séduction -lien-). Nous comprendrons, par exemple, que la femme ne produisant qu'un ovule par mois, celle-ci ait tout intérêt d'être plus regardante sur la qualité de son partenaire, alors que ce dernier produit une flopée de spermatozoïdes à chaque accouplement. Si l'on ajoute à ça la nécessité pour la femme de « fixer » son compagnon afin que ce dernier subvienne aux besoin de la famille, au moins le temps de la gestation et du début d'autonomisation de la progéniture, période durant laquelle la femme ne peut subvenir seule à ses besoin, et nous retrouverons cet aphorisme devenu lieu-commun, comme quoi : « Le sexe est le prixque les femmes paient pour se marier. Le mariage est le prix que les hommes paient pour avoir du sexe ». Quoi qu'il en soit, à l'attention de ceux qui aimeraient bien bousculer quelques stéréotypes, Olivier Klein conclut ainsi sa conférence : « les stéréotypes sont des outils de connaissance pragmatiques dont l'une des principales fonctions consiste à interpréter notre relation aux membres du groupe qu'ils décrivent. C'est donc en faisant évoluer les relations entre les groupes qu'on change le stéréotype et non l'inverse ». Et pour la route, un petit dernier en rapport avec ce qui précède, comme il se doit de Sacha Guitry : « Elle est en retard... elle viendra ! »
GG
(1) : Pour qui s'intéresse au stéréotypes relatifs à l'identité sexuelle, le texte tout autant indispensable qu'accessible de la conférence d'Olivier Klein : « Quand la psychologie compare hommes et femmes : de la science aux stéréotypes et vice versa » -LIEN-
En tant qu'être social, parler de l'humain, c'est parler du lien, des  fils invisibles qui nous lient les uns aux autres, à commencer par le langage, c'est-à-dire la culture, l'indispensable présence de l'Autre, de son histoire, de son désir, pour qu'advienne cet individu attaché de toute part : le sujet. Du coup, reconnaissant l'individu en question par le tissage des liens qui le soumettent au désir de l'Autre, il est alors tentant d'établir un lien, justement, avec notre thème précédent : le masochisme. Reste à savoir si notre sujet aime réellement ça, s'il trouve, ou espère de la jouissance par le fait même de son attachement, auquel cas, plus aucun doute, le sujet est masochiste ! Cela étant, nous avions vu qu'il y plusieurs formes de masochisme, allant du masochiste qui crée son bourreau, qui le manipule, qui définit lui-même la nature des liens qui le placeront dans une apparente position de soumission, jusqu'à la jouissance, mais aussi, le masochiste de circonstance, s'abandonnant aux fantasmes de son partenaire, généralement par amour, un sacré lien, si ce n'est un lien sacré. Là, force nous sera de constater que, dès le début, déjà tout petit, le sujet humain use de tous les moyens à sa portée pour renforcer les liens d'un attachement alors réciproque. Ainsi, qu'il s'agisse de l'enfant ou de sa mère, l'un et l'autre ont nécessité de jouir de cet attachement surpuissant qui le soumet au désir, là de sa progéniture, là de sa génitrice, insistant sur l'aspect éminemment nécessaire, vital même, de cet attachement à bien des égards masochiste. En effet, nous avons d'un coté une mère réveillée plusieurs fois par nuit, bien souvent exsangue de fatigue, cela pour que son marmot continue son travail d'usure du téton maternel, sans parler des couches malodorantes qu'il faut changer plusieurs fois par jours, les mains dans de la matière fécale dont on se demande comment un si petit corps peut en produire autant, plus des braillements à vriller les nerf de n'importe quel individu normalement constitué, etc... puis, de l'autre coté, notre bambin qui n'a rien demandé à personne, qui se retrouve là, soumis au bon vouloir maternel pour assurer sa survie, obligé de se déchirer les poumons pour en appeler audit bon vouloir, et de manière parfois bien aléatoire, contraint de quémander cette chaleur qui il y a peu encore l'enveloppait, avant que maman ne l'en expulse à grands cris et, pourquoi faire, je vous le demande, pour que nous soit révélé l'abjection du dehors, de la temporalité, de l'autre, et, au final, notre nature fragile d'être mortel. Evidemment, si la logique qu'imposa la situation fut respectée, c'est-à-dire l'éradication du problème, l'espèce humaine eut disparu avant même d'exister. Mais, la nature faisant bien les choses, comme chacun sait, elle inventa le lien, à grand renfort d'ocytocine (hormone de l'attachement), celui par lequel la mère et l'enfant jouissent de leur soumission au désir de l'autre : l'amour, un lien si bien conçu dans son absolu, que nous n'aurons de cesse d'essayer d'en résoudre le paradoxe notre vie durant, à savoir, reconstruire ces instants d'éternité pourtant soumis à l'usure du temps, jusqu'à inventer le poète, c'est dire ! Voilà, c'est ça le problème avec le lien, comme un vieux bout de chanvre il est soumis au climat, aux intempéries de la vie, au pourrissement et, pourtant, lorsque nous arrêtons d'en tisser, nous sommes malheureux... si c'est pas du masochisme ça !
fils invisibles qui nous lient les uns aux autres, à commencer par le langage, c'est-à-dire la culture, l'indispensable présence de l'Autre, de son histoire, de son désir, pour qu'advienne cet individu attaché de toute part : le sujet. Du coup, reconnaissant l'individu en question par le tissage des liens qui le soumettent au désir de l'Autre, il est alors tentant d'établir un lien, justement, avec notre thème précédent : le masochisme. Reste à savoir si notre sujet aime réellement ça, s'il trouve, ou espère de la jouissance par le fait même de son attachement, auquel cas, plus aucun doute, le sujet est masochiste ! Cela étant, nous avions vu qu'il y plusieurs formes de masochisme, allant du masochiste qui crée son bourreau, qui le manipule, qui définit lui-même la nature des liens qui le placeront dans une apparente position de soumission, jusqu'à la jouissance, mais aussi, le masochiste de circonstance, s'abandonnant aux fantasmes de son partenaire, généralement par amour, un sacré lien, si ce n'est un lien sacré. Là, force nous sera de constater que, dès le début, déjà tout petit, le sujet humain use de tous les moyens à sa portée pour renforcer les liens d'un attachement alors réciproque. Ainsi, qu'il s'agisse de l'enfant ou de sa mère, l'un et l'autre ont nécessité de jouir de cet attachement surpuissant qui le soumet au désir, là de sa progéniture, là de sa génitrice, insistant sur l'aspect éminemment nécessaire, vital même, de cet attachement à bien des égards masochiste. En effet, nous avons d'un coté une mère réveillée plusieurs fois par nuit, bien souvent exsangue de fatigue, cela pour que son marmot continue son travail d'usure du téton maternel, sans parler des couches malodorantes qu'il faut changer plusieurs fois par jours, les mains dans de la matière fécale dont on se demande comment un si petit corps peut en produire autant, plus des braillements à vriller les nerf de n'importe quel individu normalement constitué, etc... puis, de l'autre coté, notre bambin qui n'a rien demandé à personne, qui se retrouve là, soumis au bon vouloir maternel pour assurer sa survie, obligé de se déchirer les poumons pour en appeler audit bon vouloir, et de manière parfois bien aléatoire, contraint de quémander cette chaleur qui il y a peu encore l'enveloppait, avant que maman ne l'en expulse à grands cris et, pourquoi faire, je vous le demande, pour que nous soit révélé l'abjection du dehors, de la temporalité, de l'autre, et, au final, notre nature fragile d'être mortel. Evidemment, si la logique qu'imposa la situation fut respectée, c'est-à-dire l'éradication du problème, l'espèce humaine eut disparu avant même d'exister. Mais, la nature faisant bien les choses, comme chacun sait, elle inventa le lien, à grand renfort d'ocytocine (hormone de l'attachement), celui par lequel la mère et l'enfant jouissent de leur soumission au désir de l'autre : l'amour, un lien si bien conçu dans son absolu, que nous n'aurons de cesse d'essayer d'en résoudre le paradoxe notre vie durant, à savoir, reconstruire ces instants d'éternité pourtant soumis à l'usure du temps, jusqu'à inventer le poète, c'est dire ! Voilà, c'est ça le problème avec le lien, comme un vieux bout de chanvre il est soumis au climat, aux intempéries de la vie, au pourrissement et, pourtant, lorsque nous arrêtons d'en tisser, nous sommes malheureux... si c'est pas du masochisme ça !
Ici, j'ouvrirais une parenthèse au sujet de cet éternel oublié du lien lorsqu'il est question de ceux familiaux, surtout au début : le père. Aujourd'hui, en ces temps modernes où les femmes enfantantes peuvent difficilement se réduire au statut de mère, par contrainte ou par choix, les pères se voient appelés à la rescousse pour assumer eux aussi des fonctions jusqu'alors considérées maternelles, par conséquent dédiées aux femmes, alors que d'évidence la nature n'a pas doté l'homme de la même capacité à tisser du lien concernant la soumission nécessaire aux besoins de sa progéniture. Pourtant, nombre de pères, sans pour autant renoncer à leur virilité, assument avec grand plaisir (du moins en apparence) ces tâches qu'ils considèrent dorénavant non sans une certaine noblesse, et cela, quoi qu'un peu gauches, avec cette efficacité toute masculine de qui sait surmonter les adversités techniques du quotidien. Bref, l'homme moderne change une couche de façon tout aussi satisfaisante que l'ampoule de la cuisine, même si sa nature oublieuse lui fait parfois omettre de ranger l'outillage nécessaire aux dites réalisations. Reste alors de s'interroger quant à l'essence du lien qui soumet ainsi le père aux contraintes évoquées plus haut, mis à part l'usure du téton. Ici, ledit lien semble tissé d'une quantité de matériaux, avec au final une solidité fort proche de ce qu'on appelle par coutume l'instinct maternel, qui, rappelons-le, doit beaucoup à l'ocytocine, même si l'hormone en question n'est pas suffisante à tout expliquer. Bien entendu, et comme d'habitude lorsqu'il s'agit de lien, nous trouvons l'amour au premier rang de ces matériaux, l'amour que monsieur voue à la compagne dont le ventre assure la pérennité du clan, entre autre, comme en son temps la mère de monsieur, c'est beau ! Mais aussi, l'amour que monsieur se voue à lui-même par l'intermédiaire de la culture, sa culture, celle par laquelle un homme digne de ce nom, aujourd'hui, se doit par grandeur d'âme de soutenir sa compagne dans son difficile métier de femme devenue mère, un homme libéral et libéré qui peut se regarder fièrement dans son miroir, comme il y a longtemps maman le regarda, et sa femme à présent. N'oublions pas, quand même, l'amour que l'on doit à la chair de sa chair, gratuitement, juste d'être notre chair (sic). Et puis, toujours au rayon culture, ce que le terme parent implique d'abnégation, mais aussi de devoirs, quoi que ces derniers aient depuis pas mal de temps déjà comme une fâcheuse tendance d'être oubliés, les parents délaissant leur rôle d'éducateur (lien sadique ?) au profit d'une soumission soit disant assumée afin que leur moutard leur renvoie de cet amour qu'ils ont si chèrement extrait d'eux-même, laissant des enfants déstructurés, mais c'est une autre histoire, où l'on voit d'ailleurs que quelque soit notre utilisation du lien, masochiste ou sadique, la jouissance est bien difficile à atteindre.
Evidemment, il pourrait sembler curieux, voire provocateur, d'aborder ces histoires de lien par le biais du masochisme, d'autant que si nous aimons à nous laisser attacher, il est évident que d'attacher l'autre fait aussi parti de nos sports favoris, et cela, donc, dès la prime enfance. Nous serions donc tantôt masochistes, tantôt sadiques, des « pervers polymorphes » en somme, selon la formule freudienne. Certes, ceci pourrait sembler outré dans la mesure ou les liens en question n'ont pas de réalité concrète, un peu comme lorsqu'on parle de « castration » et de « phallus », quoique métaphores opérantes dans la réalité du sujet. D'ailleurs, et bien que lesdites métaphores relèvent du symbolique, l'enfant préverbal accède néanmoins à la métaphore du lien lorsqu'il crée cet objet paradoxal, puisque déjà existant, qu'est la première mouture de son objet transitionnel, généralement un bout de tissu symbolisant la présence maternelle, la sécurité dont l'enveloppe sa mère et à laquelle il ne souhaite que se soumettre. Sauf que, me direz-vous, ce lien symbolise tout autant la soumission maternelle aux désirs et besoins de l'enfant, une soumission pas toujours au rendez-vous, malheureusement, l'enfant cherchant alors à ficeler sa mère à son désir, avec punition à l'appui si cette dernière ne se soumet pas (stades sadique oral et sadique anal). Cela étant, l'ambition de notre bambin n'est pas encore (ça viendra plus tard) d'accéder à la jouissance par le saucissonnage maternel, il n'est pour l'heure question que d'un moyen, son désir étant au bas mot d'abaisser la tension générée par le manque consécutif de ses besoins non encore résolus et, au plus, de renouer avec l'homéostase intra-utérine, lorsque ladite gangue intra-maternelle consistait en cet océan de paix où n'existait pas encore le sujet, ni même l'être, à tel point que Freud ira jusqu'à parler de pulsion de mort pour évoquer ce désir d'un retour à l'état de non-désir, envisageant le but ultime de la vie comme de renouer à l'inorganique. Ainsi, nos débuts, forts prometteurs, n'useraient de sadisme que pour satisfaire nos pulsions de vie et de mort, au final pas si antagonistes que ça, et, bien entendu, en passant par l'absolu nécessité du lien, voire de la cage, dans lequel l'Autre nous enserre, et jusqu'à en jouir.
Mais si la comparaison de l'objet transitionnel avec un lien de nature sadique ou masochiste pourrait apparaitre légèrement excessive, Freud et Winnicott ont cependant mis en évidence cette propension toute enfantine pour les jeux dont l'objet principal est une ficelle, Freud avec le jeu de la bobine (-Lien-), et Winnicott à travers l'étude d'un garçon de sept ans (in Jeu et réalité) présentant des troubles en lien direct avec son goût immodéré pour les jeux de ficelle. Winnicott commencera ainsi ses observations : « La ficelle peut être considérée comme une extension de toutes les autres techniques de communication » et, plus loin, notant que la fonction de la ficelle soit susceptible d'évoluer, « passant de la communication au déni de la séparation », avec en l'occurrence les conséquences funestes que suppose le déni. Ici, l'enfant dont parle Winnicott, transformera à l'adolescence ses jeux symboliques en une addiction alcoolique, recréant ainsi en des « objets transitoires » (J Mac Dougall), sous forme de bouteilles, les liens que ses ficelles d'enfant furent incapables à tisser de manière stable. Et là encore, qu'il s'agisse de Freud ou de Winnicott, ils observeront des états très forts de plaisir et de déplaisir associés à l'usage de ce lien symbolique qu'est la ficelle en tant qu'instrument de soumission, qu'il s'agisse d'attacher l'autre, ou soi-même. Il est donc possible de voir là les prémisses de ce que nous appellerons plus tard masochisme et sadisme, sans pour autant nous laisser aller à parler de perversion, point trop n'en faut.
Mais comme nous le fait remarquer Winnicott, le lien est d'abord ce qui nous uni à l'autre, sorte de pont qu'emprunteront les protagonistes à fin de rencontre, de communication, de demande, et pas seulement un objet de jouissance où l'autre n'a de fonction que d'être le tiers nécessaire à la mise en valeur des fantasmes que nous projetterions non pas sur l'autre en question, encore mal attaché, mais sur le lien en tant qu'objet de soumission, de soi ou de l'autre. Certes, notre désir de rencontre, de créer ou de consolider le lien en tant qu'outil de communication, est toujours de répondre à des motifs personnels, quelle qu'en soit l'apparence, qu'il s'agisse de l'amoureux, de Mère Térésa, de Sade, ou de Sacher-Masoch. Finalement, en grandissant, nous apprenons juste que nous sommes irrémédiablement attaché à l'autre, perdant la saveur du lien en soi, de la ficelle, pour ne nous consacrer qu'à ses symboles : le langage et la chair. Somme toute, le sadique et le masochiste ne seraient que de grands enfants n'ayant pas bien saisi la finalité du lien, se contentant de quelques ficelles directement reliées à leur libido, en quelque sorte des fétichistes du lien. Et même, probablement pourrions-nous définir notre qualité d'être social au travers de notre compréhension du lien à des fins plus ou moins créatives, à même de choisir en connaissance de cause ceux de notre plus ou moins libre soumission, ce que nous appelons la culture, entendue comme « la tradition dont on hérite » (Winnicott), ou bien comme « la mémoire de l'intelligence des autres » (P. Rey). Mais ces liens, dont la finalité est malgré tout de nous unir à l'Autre, ne sont pas qu'objets de jouissance, ils nous sont vitaux, comme en témoigne cette expérience criminelle, voulue par Frédéric II de Hohenstaufen, afin de déterminer quelle serait la langue originelle de l‘être humain. Pour ce faire, quelques bébés furent isolés et privés de liens affectifs et symboliques, leurs besoins corporels, nourriture et soins, étant assurés de la manière la plus rigoureuse possible, en silence donc. Evidement, non seulement les bébés ne parlèrent jamais, mais se laissèrent dépérir, jusque mourir. Si la véracité de cette histoire demeure incertaine, nous sommes alors au XIIIème siècle, le psychanalyste René Spitz démontra dans les années cinquante, par le concept d'« hospitalisme », qu'une trop longue privation de liens affectifs chez le tout jeune enfant entraine une régression mentale associée à des troubles physiques pouvant, effectivement, aller jusqu'à la mort en cas de déprivation totale. Il convient donc d'insister sur l'absolue nécessité pour l'humain de tisser du lien, et cela dès le plus jeune âge. Bref, sans lien, nous n'existons pas.
Pour finir, tout en continuant à essayer d'observer ce qu'implique la notion de lien sous un angle un peu différent à l'habitude, telle la théorie de l'attachement par exemple, de John Bowlby (-Lien-), il me semble intéressant de se pencher quelques instants sur ces liens fort peu évoqués qui permettent de transformer nos processus psychiques primaires en une nouvelle dynamique dite secondaire. Ainsi, l'énergie pulsionnelle qui circule dans l'inconscient est dite primaire, c'est à dire totalement libre de contrainte, ignorant la contradiction et les jugements de valeur, circulant librement, visant à la seule décharge et que nous traduirons en terme de poussée, régie par ce que Freud a nommé « principe de plaisir ». Mais avec la formation progressive du moi, l'expérience nous oblige à adapter nos désirs en des compromis avec une réalité qu'il convient avant tout d'apprivoiser, c'est-à-dire de nous saisir des liens (vitaux) tendus par l'Autre afin d'enserrer le réel environnant en une réalité acceptable... négocier en somme. Et donc, pour négocier au plus juste avec un système qui nous préexiste, nous devons en connaître les lois (l'ordre symbolique) et les faire nôtres, sous peine de rejet. Pour ce faire, l'enfant usera de toute la panoplie de mécanismes identificatoires à sa portée, jusqu'à se parer des principes moraux qui lui semblent les plus en adéquation avec le réel environnant. Autrement dit, c'est des liens tissés avec son entourage que l'enfant construira sa réalité, une réalité que l'on pourrait ainsi dire liée. Il s'agit donc là du rapport que nous entretenons à l'extérieur, à ce qui n'est pas nous, mais sans perdre de vue que la finalité en est d'adapter nos pulsions (primaires) au monde environnant. Ainsi, de la même manière que notre moi lie le réel extérieur en ce qui devient notre réalité (secondaire), le moi s'efforcera d'accorder la pulsion (réelle, primaire) à ladite réalité, le terme consacré étant fort à propos de « lier » cette énergie primaire en des processus désirants dits secondaires, cette fois sous l'égide du « principe de réalité ». Le moi (système préconscient-conscient) a donc pour fonction de conjuguer le réel de nos pulsions au non moins réel extérieur, cela afin que les deux ne se percutent pas, nous occasionnant au passage quelques blessures tout autant réelles. Et donc, ces liens (symboliques) par lesquels notre moi saucissonne tout à la fois l'intérieur et l'extérieur afin de les accorder, laissant au passage s'en échapper l'informulable, « ce que le symbolique expulse en s'instaurant » (A. Vanier), ces liens, donc, sont ce que nous aurons conservé et malaxé, tissé, du discours de l'Autre. Autrement dit, nous en appelons à l'Autre pour lier le fondement du désir en nous, et d'espérer en jouir... si c'est pas du masochisme ça !
GG

On considère habituellement le masochisme comme étant le fait de trouver du plaisir dans la souffrance, qu'elle soit physique ou morale. Or, ce n'est pas exactement cela, car le plaisir provient des conséquences de la douleur, pas de la douleur elle-même ; le masochiste est comme tout le monde, lorsque son corps ou son âme sont agressés, il souffre, il a mal, ce qui à l'instar de chacun génère une excitation psychique, et c'est de cette excitation qu'en certaines circonstances il trouvera sa jouissance. Par ailleurs, il est difficile de parler du masochisme comme d'un bloc et, en creusant un peu la question, j'ai le sentiment qu'il existe autant de masochismes qu'il y a de masochistes. Finalement, c'est un peu comme la psychanalyse, où derrière de grands courants l'on trouve autant de pratiques qu'il y a de praticiens, sorte d'art ne se justifiant que par la singularité de qui en éprouve la nécessité. D'ailleurs, en parlant d'art et au contraire de Freud, Deleuze séparera le sadisme et le masochisme en ce que ce dernier relèverait d'une aspiration esthétique, entre autre, ce qui pour autant ne garantit pas la qualité de l'œuvre (comme en psychanalyse), alors que pour Deleuze, « l'inspiration de Sade est d'abord mécaniste et instrumentaliste ».
Disons d'abord que le terme masochisme fut élaboré par le psychiatre austro-hongrois Richard Freiherr von Krafft-Ebing (1840 - 1902) à partir du nom de Leopold Ritter von Sacher-Masoch (1836 - 1895) qui décrivit ses fantasmes désormais masochistes dans un roman intitulé « La Vénus à la fourrure ». D'ailleurs, Sacher-Masoch ne fut pas très heureux de cet honneur que lui fit Krafft-Ebing de désigner à partir de son nom ce que l'on considèrerait dorénavant comme une perversion sexuelle. A cet égard, il me semble aussi percevoir derrière l'appellation masochiste comme un jugement de valeur, une connotation morale qui, à l'instar de l'homosexualité, se voit qualifiée de perversion, alors qu'il s'agit simplement de trouver son plaisir différemment du commun. La question est par conséquent de savoir s'il y a du mal à se faire du bien en se faisant mal ? Cela étant, comme dans le roman de Sacher-Masoch, cette question n'a d'intérêt que dans le cadre d'un masochisme sexuel assumé, ce qui est bien loin d'être toujours le cas, tant sur le versant sexuel qu'assumé, notamment pour ce qui est du masochisme moral où le terme perversion semble bien excessif, à moins de juger tout ce que l'on considère de dérèglement psychique comme une perversion, sans même parler de la notion de dérèglement comme cause d'une pratique inhabituelle, dite déviante.
Freud désignera ainsi trois formes de masochisme : érogène, féminin, moral. Le masochisme érogène serait primaire, c'est-à-dire l'expression même de la pulsion, en l'occurrence celle d'une rencontre entre pulsion de vie (libido) et pulsion de mort, qui s'exprimeraient donc librement, non encore liées par le principe de réalité, avec pour conséquence une excitation sexuelle directement associée à la douleur. Quant au masochisme féminin, lui aussi sexuel, donc tout autant érogène, il serait de placer le sujet, homme ou femme, dans une position de soumission à laquelle serait associée une certaine souffrance, ce que donc l'imaginaire social perçoit de la position féminine. Notons que si l'on peut regretter cet état de fait concernant l'image de la féminité au temps de Freud, je ne suis pas persuadé qu'aujourd'hui cela ait beaucoup changé, même si les modalités de soumission sont un peu différentes, sans quoi les mouvements féministes n'auraient plus de raison d'être, et nous en sommes encore bien loin. Mais insistons sur ce que les hommes soient tout autant concernés par ce masochisme que les femmes. Par ailleurs, la distinction entre masochisme érogène et féminin me semble fort mince, sinon artificielle. En effet, l'un et l'autre aboutissant à la satisfaction sexuelle, donc érogène, ce qui au passage pourrait nous laisser douter quant à l'implication de la pulsion de mort dans cette histoire, il est tout aussi notable de constater que la douleur doit être contextualisée, plus ou moins, pour que de l'excitation y étant associée le sujet puisse en retirer du plaisir, c'est à dire qu'il y ait une mise en scène, fut-elle postérieure à la douleur. Dès lors il devient difficile de parler de processus primaire, l'appareil préconscient-conscient étant nécessaire pour que s'établisse un lien entre le stimuli douloureux et l'excitation sexuelle. A cet égard, j'ai relevé ce propos dans un forum internet consacré au masochisme : « si on me pince fortement les seins à "froid" j'ai mal . Si je suis dans un état d'excitation sexuelle cette sensation va être interprétée par mon cerveau comme un stimuli ». Peut-être, alors, devrions-nous considérer une seule forme de masochisme sexuel que l'on pourrait simplement dire érotique, où l'Eros ne peut se défaire du mythe, de l'image, qu'il soit féminin ou masculin.
Cela étant, l'appellation « masochisme féminin » est intéressante en ce qu'elle renvoie à cet autre pan de l'imaginaire social concernant les sexes, avec, si l'on peut dire, son pendant masculin : « le phallus ». Le phallus, sans réalité matérielle, donc à distinguer du pénis, est l'organe symbolique associé à une certaine image de la masculinité, c'est-à-dire comme symbolisant la loi, l'autorité, la puissance souveraine... et, pareillement au masochisme féminin, concernant donc aussi bien les hommes que les femmes. D'un coté la soumission, de l'autre la puissance (ce qui ne signifie pas sadisme pour autant). Sans plus avant disserter sur le bien fondé de ces appellations, remarquons toutefois que c'est le phallus qui est associé à la perversion, ou plus exactement son absence. Le pervers frappé de perversion, et non pas de perversité (voir l'introduction au débat : Pervers narcissique, 4ème paragraphe -Lien-), est celui qui confond pénis et phallus, refusant que maman soit privée de l'organe en question et déniant par là même le sexe féminin. Ainsi, lorsque notre pervers se retrouve confronté à un sexe féminin, submergé d'angoisse par cet inconcevable, il ne peut produire qu'une réponse délirante avec pour conséquence une sexualité aberrante. Il pourrait donc sembler curieux d'associer le masochisme féminin à de la perversion, puisque le masochiste entérinerait lui-même sa castration (symbolique) en adoptant une position de soumission dite féminine, ce qu'il est possible d'entendre comme un rejet du phallus, peut-être dénié, refoulé, ou tout simplement mis à l'écart, une sorte de rejet de l'ordre symbolique, de la loi, du « nom du père ». Evidemment, l'on pourrait aussi dire, à l'inverse, que le masochiste attribue un phallus à la femme, devenant ainsi dominatrice et endossant dans le n'importe quoi une fonction paternelle fantasmée, autoritaire et sévère. Ainsi, la femme deviendrait celle qui édicte la loi et punit le contrevenant, le terme « maitresse » prenant ici tout son sens.
Mais tout cela pose quand même de nombreuses questions, notamment en terme de structure, si toutefois l'on voulait absolument caser nos sujets masochistes dans une structure donnée, ce qui semble pour le moins illusoire. Rappelons que tout le monde (psychanalytique) est à peu près d'accord pour dire que le psychisme humain s'organise selon trois grands types de structures, sauf certains lacaniens pour qui la seule structure est celle du langage. Là encore, beaucoup s'entendent dans les grandes lignes sur la définition des structures névrotiques et psychotiques, la troisième étant selon les écoles, soit perverses, soit limites, cette dernière pouvant aussi être comprise en tant qu'astructurations (voire le tableau sur les structures de la personnalité, d'après Bergeret, à la fin du texte « Les états limites » -Lien-). Quoi qu'il en soit, la perversion entre dans la troisième catégorie structurelle, que l'on dira ici comme s'intégrant dans celle des états limites, parmi bien d'autres personnalités, celle perverse étant la plus proche de la lignée psychotique (in La personnalité normale et pathologique, Bergeret). Mais ce qui importe est de savoir que ces trois entités structurelles impliquent des organisations psychiques radicalement différentes les unes des autres, et qu'il semble bien difficile d'intégrer le masochisme dans une seule d'entre elles, notamment pour ce qui concerne le rapport entre masochisme et sadisme, parfois avéré (sadisme retourné contre soi) et d'autres non. Par exemple, un masochiste pervers (état limite) n'a rien à voir avec celui pris dans une angoisse de castration (névrotique), le premier étant soumis de manière sous jacente à la honte et le second à la culpabilité (voire l'introduction du débat : La culpabilité -Lien-). Autrement dit, il n'y aurait pas un masochisme, mais de nombreuses formes, qu'il s'agisse de masochisme moral ou érotique, la branche perversion n'étant qu'une de ses formes au sein du registre érotique. En somme, ni plus ni moins que dans la sexualité en général, qu'elle soit homo ou hétéro. Sans doute faut-il voir là le grand flou qui dans la littérature psychanalytique enveloppe le masochisme, chacun se focalisant sur un aspect singulier de la question, mais échouant à toute conceptualisation globale.
Au fond, chaque hypothèse concernant le masochisme érotique, depuis Freud, semble à peu près fondée, et il y en a bon nombre, mais ne pouvant faire généralité. Quant au masochisme moral, consistant pour le sujet à créer une situation induisant chez lui de la souffrance psychique, hors du champ sexuel, je serais plus réservé. Déjà, nous constaterons la forte propension de chacun à étiqueter l'autre en tant que déviant (cinglé) lorsque ce dernier s'adonne à des comportements qui chez nous génèrent de l'angoisse et chez lui du plaisir. Par exemple, afin d'illustrer notre débat, j'ai placé sur l'affiche de celui-ci une femme en prise avec un appareil (de fitness) qui pour nombre d'entre nous s'apparente tout bonnement à un diabolique engin de torture, et sur lequel il faudrait nous maintenir pieds et poings liés. Pourtant, la dame a l'air contente d'avoir dépensé ses sous pour ce truc de malade, par surcroit d'une esthétique douteuse. Force alors me sera de conclure qu'elle est « maso », et elle de penser que je suis un âne. Et encore, je ne parle pas des sports extrêmes, ou de certaines pratiques religieuses, quoi que là nous puissions légitimement nous interroger, la religion entretenant des liens très étroit avec le masochisme, tant moral qu'érotique. Songeons aux pratiques de contrition, ou à certains récits de martyrs pour qui la souffrance était un moyen de jouissance, aussi bien morale que sexuelle, et que dire du sacrifice de sa sexualité au nom du Père. Toujours au registre de la réserve, comme quoi la plus grande prudence devrait s'imposer avec l'étiquette de masochisme moral, cette remarque de Michel de M'Uzan : « La recherche de l'échec, de la peine, l'assouvissement d'un besoin profond de châtiment, c'est bien avec cette trame commune à la plupart de ses patients que l'analyste a essentiellement à faire » (in De l'art à la mort). Si l'on ajoute ceux des masochistes heureux éprouvant du plaisir suite à la douleur, c'est-à-dire n'ayant aucune raison d'aller chez le psy, plus tous ceux qui ont besoin d'un maitre pour exister, plus les jouisseurs de la modestie, etc. et l'on finirait par se demander si la majorité d'entre-nous ne serait pas quelque peu masochiste ? En somme, dans la mesure où le symptôme est reconnu parce qu'il produit de la souffrance, que ledit symptôme peut être considéré comme une défense visant à maintenir l'angoisse à distance, la plupart de nos symptômes psychiques (sans cause organique) pourraient alors être compris comme participant du masochisme moral, qu'il s'agisse de l'obsessionnel, de l'hystérique, du dépressif, des affections psychosomatiques, des conduites addictives, etc... bref, la notion même de masochisme moral me semble fort discutable.
Donc, laissant comme son nom l'indique le masochisme moral aux moralisateurs, il me semble intéressant de faire part d'une hypothèse induite par des réflexions de Michel de M'Uzan concernant certaines formes de masochisme sexuel, avec toutefois cette réserve préalable de de M'Uzan : « Comment la souffrance physique mène-t-elle à la jouissance ? Là dessus on ne peut guère avancer que des hypothèses ». Il s'agirait donc, pour reprendre l'expression de Michael Balint, d'une sorte de « défaut fondamental » dans les processus d'individuation, au tout début, lors de la formation du moi, lorsque le nourrisson commence à percevoir de l'extérieur à lui-même, où s'impose donc pour l'enfant la nécessité de protéger son moi naissant. En effet, comme le disait Freud, « l'objet nait dans la haine », c'est-à-dire, à peu de chose près, au moment de la transition entre le milieu intra-utérin, protégé, et le dehors où dorénavant la survie de l'enfant dépend d'objets extérieurs, à commencer par le sein maternel, un sein qui tôt ou tard se révèlera menaçant en ce que l'enfant n'en a pas la maitrise. En somme, tant que l'objet est là, comme dans le ventre maternel, l'enfant n'a pas à le distinguer de lui-même, l'existence de l'objet (le sein) ne devenant manifeste que de par son absence, redoutée, et finalement haïe. Ainsi, peu à peu, se forment les frontières du moi, et plutôt que de dire dans la haine, contentons-nous de dire dans la souffrance (voire l'introduction au débat : La haine -Lien-). De là, par l'ambivalence de l'objet aimé et haï tout à la fois, l'enfant développera une sorte de destructivité qui deviendra coupable à mesure que se forme son moi, passant selon Mélanie Klein de la position « schizo-paranoïde » à celle « dépressive ». C'est donc dans ce grand fracas où l'homéostase voisine avec la souffrance, la haine, la colère et la destructivité, que se forme le moi du sujet. Or, en cas d'inachèvement de ce processus d'individuation, le moi du sujet conservera une sorte de destructivité fonctionnelle associée à sa propre souffrance. Ainsi, pour achever ledit processus, distinguer sans ambiguïté son moi de l'autre (l'objet), le sujet peut être amené à rejouer cela, allant jusqu'à établir un contrat avec un tiers persécuteur qu'il aura en quelque sorte lui-même créé afin d'inscrire dans la douleur, comme il se doit, les frontières encore mal définies de son moi.
Pour finir, il me semble important d'insister sur cette notion de contrat, soulignée par Gilles Deleuze, que le masochiste passe avec son sadique de service, contrat par lequel le persécuté impose sous une apparente soumission la forme des sévices que l'autre devra sans tergiverser lui infliger. Ainsi, le masochiste est-il son propre bourreau, le tiers n'ayant de valeur qu'en tant qu'objet nécessaire à la distinction moi-non moi. Mais comme dit plus haut, il y a autant de masochismes que de masochistes, et une seule hypothèse ne parviendra pas à cerner ce qui, au fond et à divers degrés, concerne nombre d'entre nous. J'ajouterais, juste, que je fus surpris en m'intéressant à ce thème, et allant voir sur des forums de discussion consacrés au masochisme, par la qualité inhabituelle pour internet de certaines conversations, laissant penser que, sans même entrer dans son argumentation, Deleuze ait au moins en partie raison pour ce qui est d'une volonté esthétique associée au masochisme, même si comme toujours il est difficile de généraliser.
GG
« Choisir, c'est renoncer » ; cette citation attribuée à André Gide signifie que to ut choix implique un jugement de valeur entre ce qui nous est plus ou moins bon, plus ou moins nécessaire, du moins en apparence, parce que nous avons tous éprouvé certains de nos choix comme n'étant pas toujours les plus judicieux. Si l'on ajoute à ça la faculté de nous créer des problèmes dont les fondements sont parfois assez obscurs, nous voyons que nous sommes constitués en tant que sujet par de la subjectivité mise en acte au travers de cet impératif de choisir pour avancer, c'est à dire d'analyser, puis de synthétiser, et même de créer différentes options pour parvenir à la résolution de nos désirs. Et là, déchirement, lorsque nos choix produisent des restes viables auxquels il nous faut renoncer, comme de laisser une part de notre désir sur le bas-coté, subjectivement. En somme, seule l'évidence, le non choix, est sensée nous protéger de ce que l'on pourrait entendre comme une sorte de renoncement de soi, laissant alors notre subjectivité travailler en sous-main, hors conscience, car parler de choix suppose évidement une décision, c'est à dire en conscience.
ut choix implique un jugement de valeur entre ce qui nous est plus ou moins bon, plus ou moins nécessaire, du moins en apparence, parce que nous avons tous éprouvé certains de nos choix comme n'étant pas toujours les plus judicieux. Si l'on ajoute à ça la faculté de nous créer des problèmes dont les fondements sont parfois assez obscurs, nous voyons que nous sommes constitués en tant que sujet par de la subjectivité mise en acte au travers de cet impératif de choisir pour avancer, c'est à dire d'analyser, puis de synthétiser, et même de créer différentes options pour parvenir à la résolution de nos désirs. Et là, déchirement, lorsque nos choix produisent des restes viables auxquels il nous faut renoncer, comme de laisser une part de notre désir sur le bas-coté, subjectivement. En somme, seule l'évidence, le non choix, est sensée nous protéger de ce que l'on pourrait entendre comme une sorte de renoncement de soi, laissant alors notre subjectivité travailler en sous-main, hors conscience, car parler de choix suppose évidement une décision, c'est à dire en conscience.
Choisir renvoie donc à la notion de subjectivité, où la culture du sujet, son désir, conditionne une décision parmi d'autres possibles, ces dernières étant peut-être tentantes, mais qu'il nous faut apprendre à sacrifier au profit de ce que nous estimons le meilleur choix, subjectivement donc. Pourtant, il nous arrive de croire en des choix objectifs, que l'on qualifiera alors de rationnels, histoire d'adoucir un peu le renoncement, comme si le désir à l'origine du choix, la culture, la morale, furent irrationnels, laissant penser que seule l'expérience, en tant qu'éprouvé de la réalité, nous donna les moyens de choisir en toute impartialité. Il y aurait donc, d'un coté, une façon de choisir que l'on pourrait dire mathématique, où l'on pose une équation avec des éléments connus et d'où émerge une solution qui s'impose en tant que produit logique d'une opération, comme par exemple de cocher savamment une case dans un questionnaire à choix multiples (QCM), puis, de l'autre coté, une manière de choisir intuitive, c'est à dire où certains éléments de l'opération font partie d'un savoir inconscient où fantasmes, résistances, pulsions, désir, sont aussi parties intégrantes dudit savoir, cette fois fondé sur notre éprouvé du réel, et dont le produit se résout de manière inconsciente. En somme, ce que l'on perçoit d'objectif ou de subjectif résulte de la connaissance ou non des causes qui déterminent nos choix.
Malgré tout, il me semble difficile d'associer choix et objectivité, du moins dans une perspective humaine, non mécanique, les machines ne produisant pas selon des choix subjectifs, quoi qu'éventuellement aléatoires, mais nullement fondés sur un savoir inconscient et néanmoins opérant. Si l'on reprend l'exemple du QCM, de deux choses l'une, ou je connais la réponse, ou je ne la connais pas, autrement dit, même si le questionnaire comporte par exemple quatre « choix » possibles, l'alternative se résume pour moi à deux entrées, je sais ou je ne sais pas. Si je sais, le choix éventuel consiste donc à estimer s'il est bon pour moi d'apporter ou non la bonne réponse, le choix ne concernant donc pas le QCM, mais celui de ma position face audit questionnaire. Par contre, si je ne sais pas, ou bien je m'en remet au hasard pour « choisir » à ma place, et il est donc difficile de parler de choix pour ce qui me concerne, ou bien j'essaie de répondre intuitivement en espérant que mon savoir inconscient soit plus fourni que mon savoir conscient, laissant à ma subjectivité le soin de choisir entre les options proposées. Puis, une fois le choix accompli, nous revenons à la première alternative, celle du « je sais », à la différence que le savoir est ici espéré, mais ne changeant pas les termes de l'alternative. En somme, le seul véritable choix concernant spécifiquement le problème qui m'est posé, celui de déterminer la bonne réponse, est lorsque je ne sais pas, que je ne suis pas sûr, que j'hésite, c'est pareil. Il n'y a donc pas de choix dans la certitude que sous-tend l'objectivité, mais une évidence vers laquelle je me dirigerais ou non, déplaçant ainsi le choix vers les termes d'une autre question, et ainsi de suite. Il n'y a donc de choix que subjectif, c'est à dire comprenant une zone d'incertitude, d'où la difficulté de renoncer à un éventuel meilleur, ou bien, s'il y a plusieurs choix possibles, de renoncer à du « pas mal quand même », en sorte que je crée moi-même la possibilité d'une satisfaction non résolue. D'ailleurs, peut-on parler de choix s'il n'y a rien à quoi renoncer ?
Reste que pour élaborer ma réponse face à un choix, il me faut analyser la question, décomposer le tout en ses parties, c'est à dire déterminer les termes de ma compréhension au regard de l'énoncé. Ici s'opère un premier choix en ce que j'ignore les causes des termes en question (le langage me préexiste, ce n'est pas moi qui l'ai inventé) et, pareillement, j'ignore consciemment les mécanismes de représentation associés aux dits termes (le signifié). De là, une fois que j'ai compris la question, recomposé les parties en un tout, une synthèse, subjectivement donc, je dois trouver le chemin, le raisonnement qui me conduira à ce que j'espère être la (les) solution(s), avec toujours la même zone d'incertitude quant au choix des termes balisant ledit chemin. En somme, répondre subjectivement, choisir ma voie, c'est remettre de la question à l'intérieur de la question, c'est être créatif. D'ailleurs, l'histoire de la pensée nous montre que les avancées de cette dernière s'effectuent lorsqu'on va chercher les questions non résolues qui présidèrent à l'élaboration des réponses apportées. Ainsi, puisqu'il est question de langage, une méthode simple d'analyse de la question est d'examiner l'étymologie des mots qui la compose et d'en saisir les nécessités d'articulation, de liaison. Nous qui fréquentons les cafés philo sommes coutumiers de cette pratique, mais, bien souvent, les réponses apportées de cette manière sont insatisfaisantes, car l'étymologie ne fait pas cas du sens actuel que le locuteur donne à sa proposition, ce qu'il entend par là, le signifié, alors que c'est justement dans le choix des termes de notre compréhension que nous parviendrons peut-être à établir un pont entre son signifié et le notre, en toute subjectivité, par le choix d'un autre chemin, et, avec un peu de chance, d'ouvrir aux questions non résolues de la proposition. En somme, parler et entendre, échanger, consiste déjà en des choix, c'est à dire à être créatif dans une zone d'incertitude.
Tout choix est donc au moins en partie subjectif et contient en lui une part de renoncement. Par ailleurs, notre subjectivité étant le produit de notre expérience, de notre histoire, de ce que nous avons engrangé de savoirs conscients et inconscients comme conditionnant notre lecture du monde, nous comprendrons par conséquent que notre passé soit la cause de notre interprétation du présent, même s'il pût en être autrement, un passé dont beaucoup échappe à notre conscience, mais dont le produit demeure opérant en tant que notre subjectivité. Ainsi se pose la question de notre libre arbitre quant à notre capacité de choisir et, peut-être surtout, de ce que nous sommes en mesure d'apercevoir, et même de créer, comme choix opportuns. Spinoza nous dit ainsi que les hommes se croient libres parce qu'ils ignorent les causes qui les déterminent. A l'appui de cela, nous savons par exemple que la structure psychique de l'individu s'établit durant l'enfance, limitant ainsi le champ des possibles en matière de modes relationnels, de nature de l'angoisse, de défenses que le moi établit contre cette dernière, etc... avec au final un registre de personnalités limité par ces causes qui donc nous contraignent dans nos choix. Cela étant, même si ledit registre est limité, il y a quand même autant de manière de s'adapter à une structure que d'individu s'y inscrivant. Mais même sans aller du coté de la personnalité en tant qu'émanation visible de la structure, tout le monde ne partageant pas ce point de vue, il suffit de songer comme cause de nos choix à nos conflits intérieurs entre principe de plaisir et principe de réalité. Or, chacun de nous, selon son degré d'évolution psycho-affective, n'entretient pas le même équilibre entre lesdits principes, celui de réalité ne devenant prépondérant, voire encombrant, que lors de la période œdipienne, par identification à la symbolique paternelle, mais beaucoup de personnes ne parviendront pas à ce stade (ce qui n'est pas une tare). Quant au principe de plaisir, s'il n'est pas, ou mal canalisé par celui de réalité, on en vient vite à heurter violemment ladite réalité, et à s'y faire mal. Bien entendu, tout ceci relève d'une dynamique inconsciente, produit d'un passé dont nous conservons la trace, voire l'empreinte, sous forme de représentations, c'est à dire de vestiges mnésiques inconscients investis affectivement, moteurs de nos fantasmes et de la partie désir de nos pulsions, par opposition à la partie besoin, purement organique (voir l'introduction au débat : Le désir - Lien -, pouvant alors s'envisager comme la partie dynamique de notre subjectivité, origine de nos choix).
C'est donc la question de notre liberté qui est posée lorsqu'on parle de choix : sommes-nous libres, ou déterminés ? Aux extrêmes, nous aurions un fatalisme moderne (déterministe) représenté par Diderot, héritage du stoïcisme grec et, à l'autre bout, Descartes, pour qui « la liberté de notre volonté se connait sans preuve, par la seule expérience que nous en avons », ou encore Sartre, pour qui l'homme est condamné à être libre, n'étant rien d'autre que l'ensemble de ses actes, de son projet. Par ailleurs, l'homme dans sa nature étant partie de l'univers, la science moderne, avec la théorie du chaos ou le principe d'incertitude d'Heisenberg (comme quoi la vitesse et le déplacement des particules sont certes soumis à la nécessité, mais aussi au hasard), semble infirmer l'hypothèse de Laplace pour qui « nous devons envisager l’état présent de l’Univers comme l’effet de son état antérieur, et comme la cause de celui qui va suivre », c'est à dire d'un avenir calculable. Quant aux sciences humaines contemporaines, sociologie et psychanalyse, héritières de la philosophie, nous pourrions dire qu'elles en arrivent l'une et l'autre à cette même conclusion, qu'à la notion de déterminisme soit substituée celle d'influence, c'est à dire que nous soyons en mesure d'introduire dans nos choix des éléments contingents, déterminés mais pas nécessaires, ce qui finalement semble tomber sous le sens, à savoir que nous sommes influencés par notre passé, mais nullement déterminés par lui en un avenir tout tracé.
Dès leurs débuts, la sociologie et la psychanalyse s'emploieront à démontrer comment le sujet conscient, désirant, choisissant, est manipulé par un contexte dont il n'est pas la cause, et que ce soit Durkheim, pour qui l'individu est socialement déterminé, ou bien Freud, disant que le moi n'est pas maitre chez lui, tous s'accordent à reconnaître une certaine forme de déterminisme, mais laissant place au contingent, à ce qu'une chose arrive ou non... selon nos choix, parfois bien hasardeux. Ici, nous retrouvons Spinoza pour qui la liberté s'acquiert en quelque sorte par la connaissance des causes qui nous déterminent, où l'on est donc en mesure de choisir selon nos nécessités, et non sous l'effet d'une contrainte extérieure. Nous pourrions certes rétorquer que nos nécessités se déterminant sous la contrainte d'un environnement dont nous ne sommes pas la cause, que nos choix sont le produit d'une somme de contraintes extérieures, sauf, à considérer le sujet, l'agent, tout simplement l'individu, comme cause de la réalité, sa réalité, dont nous savons qu'elle n'est pas celle du voisin, et produisant donc des nécessités singulières. En somme, Spinoza nous invite à la psychanalyse, à l'introspection, à augmenter notre « puissance d'agir » par la pertinence de choix élaborés en connaissance de cause. Nous voilà donc revenu au début et la zone d'incertitude qu'implique le choix, car la connaissance de nos nécessités ne peut que se perdre dans la méconnaissance du désir de l'Autre, à lui-même inconnaissable : « le désir de l'homme, c'est le désir de l'Autre » (Lacan). Ainsi, nos nécessités nous étant toujours en partie étrangères, bien que constituant notre réalité, même nos choix les plus judicieux seront en tous les cas confrontés à ce reste inconnu auquel il est si difficile de renoncer. Bref, choisir, bien plus que renoncer, c'est perdre.
Choisir n'est donc pas une mince affaire, puisqu'il s'agit de notre capacité de renoncement, de nous résoudre à la perte, comme aux premiers temps de notre histoire, lorsque pour accéder à l'autonomie nous dûmes nous éloigner du giron maternel, renonçant peu à peu à cette sécurité au motif de ladite autonomie, nécessaire et nullement contrainte, par choix donc, premiers pas vers une libre nécessité. Mais choisir, c'est aussi faire confiance à notre subjectivité et, par conséquent, à l'image que l'on se fait de soi, c'est à dire d'avoir construit suffisamment de sécurité intérieure pour créer une réalité où l'on puisse se déplacer au gré de nos nécessités, et si possible en connaissance de cause. Selon Spinoza, c'est ainsi que nous accédons à « la joie » mettant en œuvre celles de nos passions qui nous grandissent. Ainsi, lorsque je suis au restaurant, avec mes kilos superflus, et que s'offre à moi de choisir entre des frites et des haricots verts pour accompagner mon plat, je n'accèderais à la joie spinoziste qu'en ayant vaincu mon désir de frites, en connaissance de cause et joyeux d'avoir rejoint à mes nécessités, grandi de mon effort et tout près au régime salvateur. Mais bon, c'est triste les haricots verts, le soir, au restaurant... et qu'il est dur de perdre des frites.
GG
Liens :
- Puis-je être libre malgré le déterminisme ? - lien -
- Audio : L'inconscient, le déterminisme et la liberté ; par Serge Cottet : - lien -